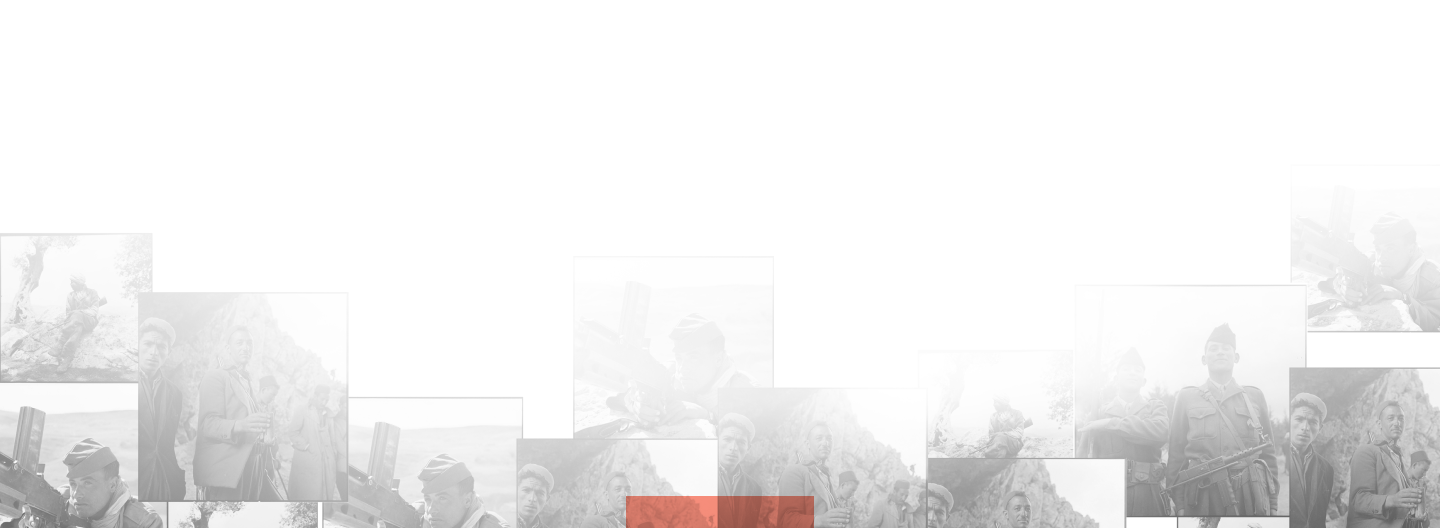Découvrez le témoignage de Marc ASSOUS
Il livre ici, sous la forme d'un court roman, l'histoire de sa famille de l'Algérie à la France.
Le but est de transmettre cette histoire pleine de non dits, saturée de silence, pour ne jamais oublier...
Retrouvez le lien de téléchargement de ce témoignage puissant en bas de page...
À la mémoire de Achène mon oncle et Mouloud mon grand-père.
« Seul l’arbre qui a subi les assauts du vent est vraiment vigoureux, car c’est dans cette lutte que ses racines, mises à l’épreuve, se fortifient. » Sénèque
Ce livre a d’abord été écrit pour ma famille et ma fille Julia. Il était avant tout personnel. L’objectif était que ma fille, mes neveux et nièces connaissent le passé tumultueux de leurs grands-parents. Puis, à la demande de nombreux amis qui souhaitaient se procurer ce témoignage, j’ai décidé de réécrire cette Histoire, mais en changeant le nom des lieux et des protagonistes. Certains ont gardé leurs vrais noms.
« La semaine dernière, dans une des belles villes du Midi, ont eu lieu, sobres et discrètes, les funérailles d’un officier. Cet homme avait passé les 90 ans, beaucoup de ses amis ne sont plus et sa famille, dispersée dans toute la France, n’était pas venue au complet. Dans la cathédrale très claire où était célébrée la messe, on repérait trois personnes – comment dit-on dans le sabir politiquement correct ? « Issues de la diversité ? » –, un couple âgé et un jeune homme. Ces trois-là venaient de Lorraine et comme les proches du défunt les remerciaient d’avoir fait ce long voyage, Mokrane, le chef de famille, a dit qu’il n’aurait manqué la cérémonie pour rien au monde. « C’était mon père », a-t-il ajouté.
Mokrane a été un harki. Fils d’un cultivateur de Kabylie, jeune marié et jeune père, il s’est engagé avec des dizaines d’autres dans la compagnie que commandait l’officier, alors capitaine, au sud de Bougie. »
La chronique de Laurence Cossé, la Croix, 06/04/2016
« Une invitation à garder une trace pour ne jamais oublier cette histoire. »
Cet article a été pour moi « ce jeune homme », fils « du couple âgé » le déclencheur de cette écriture de l’histoire particulière de mes parents.
Ce couple humble, respectueux des autres a été, bien malgré lui, l’acteur d’un des terribles drames du 20e siècle : la guerre d’Algérie.
Cet officier, décédé en 2016, « ce père de substitution, ce guide, cette référence », comme le diront souvent mes parents, était celui qui leur a sauvé la vie.
Ce chiffre 6 de 2016 résonne dans ma tête comme une réminiscence.
6 comme 2016. C’est la mort de Louis, considéré par Mokrane et sa femme comme leur père de cœur.
6 comme 2006. C’est l’agression violente de Mokrane en pleine rue, dans sa ville, au motif qu’il était un ancien Harki.
6 comme 1956. C’est l’assassinat du frère de Mokrane. Le début de l’engrenage infernal qui amènera mes parents à choisir leur Destin.
La disparition de cet officier, était pour moi, le moment propice pour ouvrir ce douloureux chapitre de la Guerre d’Algérie. Comme une invitation à garder une trace sur tout ce que m’a raconté mon père depuis tant années, pour ne jamais oublier cette histoire, qui parfois m’indisposait et m’ennuyait. Moi qui n’aspirais à l’époque qu’à jouer avec mes camarades, loin de ce tumulte intérieur de Mokrane et Lila.
Mais par où commencer ?
Peut-être par cet épisode de 2006.
Il faisait lourd ce jeudi 17 août à Mont-Saint-Martin, jolie petite ville de Meurthe et Moselle. L’orage grondait au loin, comme si s’annonçait une tempête. Les rues étaient désertes.
Mokrane, 70 ans, les traits marqués par des années de travail dans une fonderie métallurgique, profitait d’une retraite méritée auprès des siens dans son pavillon en Lorraine construit dans les années soixante-dix.
Sa peau mate, ses cheveux blancs, ses longs cils noirs, son regard perçant et son accent, trahissaient son origine méditerranéenne. Sa maison, il l’avait au fil du temps transformé pour la faire ressembler à sa ferme en Kabylie. Poulailler, moutons, jardin, récupérateurs d’eau pluviale donnait à cet endroit un aspect très rural.
Les figuiers qu’il avait plantés là « juste pour essayer » comme il disait, s’étaient multipliés et avaient donné de majestueux arbres qui ornaient tout l’espace de son terrain. Comme s’ils étaient devenus des totems, des marqueurs de son origine méridionale.
Les oiseaux étaient pour Mokrane ses pires ennemis, car ils se régalaient de ces fruits juteux et sucrés. Il passait la plupart du temps à trouver un moyen pour les empêcher de profiter de cette nourriture gratuite à disposition. La maison se trouvait ainsi entremêlée de fils reliés à des cloches que Mokrane actionnait lorsqu’il surprenait les oiseaux, pour les faire fuir. Il avait même acheté un aigle factice, estampillé made in china qui tournait autour du jardin, dès que le vent se levait. Un leurre inefficace qui nous faisait bien rire.
La vente de ces figues permettait d’améliorer l’ordinaire de la famille. Chacun venait chercher son panier de ces fruits sucrés et dorés par le soleil de l’Est.
Cette ville de Mont–Saint-Martin, Mokrane et Lila avaient appris à l’aimer.
Ils en étaient des habitants estimés et reconnus. Leur histoire avait ému certains, les prenant en affection. Ils s’étaient faits une place honorable auprès des notables de la bourgade.
Ils y vivaient paisiblement, après tous les fracas de la guerre et le déracinement qui a été le leur.
Ce 17 août 2006, Mokrane raccompagnait son neveu à la gare. Ce dernier venait tout droit de sa Kabylie natale, donner des nouvelles de la famille restée au pays et apporter un goût de là-bas : dattes, huile d’olive, figues sèches.
Sur la route, ils croisèrent à l’entrée de la gare deux femmes maghrébines passablement alcoolisées qui vociféraient sans gêne. Personne pour les faire taire. La gare était déserte.
L’orage grondait au loin de plus en plus fort. L’atmosphère s’alourdissait.
Mokrane et son neveu se mirent à débattre de ce comportement honteux, à l’inverse des valeurs de « chez eux ».
L’une d’elle reconnut mon père, ancien Harki, membre très actif d’une association d’Anciens Combattants.
Cette affiliation était pour lui le signe de reconnaissance de son histoire, mais aussi une fierté, qui allait à l’encontre des sympathisants de la cause algérienne et qui sonnait comme une provocation.
Elle se mit à l’insulter de « sale harki », de « traître », de « vendu à la France. »
Mokrane lui ordonna de cesser immédiatement ses insultes.
Voulant faire bonne figure devant son neveu, mon père son neveu accompagna sur le quai. À son retour, cette femme continua à le provoquer et s’approcha. Elle lui asséna un violent coup de sac qui le mit à terre. Lui qui venait de sortir de l’hôpital pour une éventration.
Un homme surgit de nulle part, descendit de sa voiture à toute allure pour continuer à le frapper. Ils étaient maintenant à trois contre lui. À terre, il n’avait plus les moyens de se défendre, tant la douleur était insupportable.
Personne dans la gare ni aux alentours. Ces trois-là le laissèrent agoniser et s’enfuirent.
Mokrane resta au sol. Retrouvant assez de force, il regagna sa maison en vacillant. Il en avait connu d’autres dans sa vie ! Aux urgences le verdit tomba : éventration et côtes cassées.
Une plainte fut déposée, mais aucun témoin ne put confirmer cette agression. L’affaire était classée sans suite.
Comment en était-on arrivé là, quarante-quatre ans après la fin de la guerre d’Algérie ?
La guerre continuait dans la tête de mon père. Elle était devenue larvée, indirecte. Elle se répétait inlassablement. Mokrane ne souhaitait qu’une chose : se venger.
Ses enfants, eurent envie de lui faire justice. Mais Lila, connaissant que trop bien la rage de son mari, tempéra leur envie d’en découdre.
À l’hôpital, ce fut l’occasion pour lui de me confier son histoire dramatique, et comprendre pourquoi en 2006, tout était encore à vif.
Mon père est né en 1935 dans les montagnes escarpées de la petite Kabylie. Il avait un frère, Tarek, plus âgé de 10 ans. Ses parents étaient des cultivateurs aisés qui disposaient de centaines d’hectares de figuiers et d’oliviers dans les montagnes.
Les kabyles étaient avant tout des arboriculteurs. Le relief les contraignait à ce type d’agriculture. C’est pourquoi la confection de bijoux et de tapis complétait l’éventail des revenus de ces montagnards.
Ainsi, pour vivre, les kabyles devaient souvent émigrer en France pour travailler et subvenir aux besoins de leur famille. C’est le cas de Mohammed, le père de Mokrane. Il était très souvent en métropole et occupait la fonction de gardien dans une entreprise chimique à Marseille. Il avait participé à la 1ère guerre mondiale et fut blessé à Verdun.
Mohammed, souvent absent, c’est l’aîné de la famille, Tarek, qui faisait office de chef de famille. Mokrane le respectait comme son père. Il était sa référence, son modèle.
Bagarreur, respecté, ambitieux, Mokrane était tout le contraire.
Chétif, réservé et souvent dans les jupons de sa mère Taous.
Ainsi, entre sa naissance en 1935 et le début de la guerre d’Algérie en 1954, cette petite famille vit le quotidien de ces paysans de la terre. C’est-à-dire une existence rude et laborieuse.
La Kabylie est faite de traditions, de coutumes que chacun doit respecter. Il existe dans ces villages une valeur essentielle : le code de l’Honneur. C’était « Œil pour œil, dent pour dent ». Chacun l’acceptait et l’appliquait à la lettre. Cette règle sera malheureusement très utilisée au moment de la guerre d’Algérie.
Tarek, l’aîné de Mokrane, était connu dans le village comme un homme fort et estimé. Il était, comme toute sa famille, un « marabout », c’est-à-dire qu’il descendait du Saint ayant créé le village. Il y avait donc une certaine déférence à son égard.
On le voyait souvent se battre et faire respecter les limites de ses terres. Malheur à celui qui entrait sans autorisation. Mokrane l’admirait et voulait lui ressembler. Il était son héros.
Lui, était sous l’emprise de son cousin qui le violentait souvent car considéré comme trop soumis, fragile. Taous, sa mère essayait de le protéger, mais n’avait pas suffisamment d’autorité pour se faire entendre des hommes de la famille.
En 1954, Mokrane se marie avec Lila, une jolie kabyle du village d’à côté. C’est un mariage d’intérêt dont le but est d’agrandir les terres de la famille. Elle a 15 ans et lui 19. Ce sont encore des enfants. Lui, le chétif, le peureux, le voilà propulsé dans le monde des adultes qu’il ne comprend pas.
Le mariage est célébré dans la tradition kabyle. Les youyous, les danses résonnèrent toute la nuit. L’odeur du couscous et du mouton pimentèrent cette fête.
Mais, le 1er novembre de cette même année 1954, une autre célébration se faisait jour : la « Toussaint rouge » marquait le début de la guerre d’Algérie. Elle sonnait le départ d’une série de meurtres, d’attentats, qui allaient ensanglanter la terre africaine pendant 8 ans.
Dans le village, on entendait les échos lointains de ces drames qui commençaient. Les montagnes kabyles devinrent vite le lieu de toutes les grandes batailles. Cette région montagneuse située à l’Est, permettait aux soldats du FLN de se cacher avant de rejoindre la Tunisie.
Le village de Mokrane se trouvait à quelques kilomètres de la willaya III, région où se cachait le célèbre colonel Hamirouche. Pour tenter de l’arrêter, les soldats français s’installèrent peu à peu sur les collines surplombant le village. Le ballet des hélicoptères remplaçait le doux chant de la sitelle kabyle.
Mokrane aperçut au loin le drapeau tricolore qui flottait, c’était la première fois qu’il voyait de sa vie des Français. Mais il restait à l’écart de ces événements, s’occupant de la ferme et des multiples tâches du quotidien.
En 1955, pourtant, il allait se voir confronté directement à ce conflit. Son oncle fut assassiné pour une terre qu’il n’avait pas voulu céder à un des chefs locaux du FLN.
Les règlements de compte avaient commencé. La guerre permettait toutes les exactions, même les plus sordides. Toute la famille en était affectée, mais n’osait pas se venger par peur des représailles. L’année 1956 marque aussi une nouvelle étape dans cette guerre qui ne dit pas encore son nom.
Les grands leaders du FLN se réunirent dans la vallée de la Soummam, à quelques kilomètres du village de mon père et instaurèrent comme programme politique « la Terreur ».
Il s’agissait de faire adhérer le peuple algérien en masse à la cause de l’indépendance par la peur.
Aider les rebelles ou connaître la mort, tel était le cruel dilemme auquel durent faire face les villageois.
La crainte s’installait partout dans les foyers et le village de mon père n’y échappait pas.
En réponse, l’armée française proposa aux paysans de se réunir en groupe d’auto-défense. Elle choisit un chef pour chaque hameau qui parlait français.
Le frère de Mokrane devint l’un d’eux. Cette fonction d’intermédiaire était risquée.
Les rebelles du FLN comparait cela à de la traîtrise. Les officiers français le savaient aussi. Mokrane avait prévenu son frère d’être prudent. Ce dernier lui répondait qu’il était assez fort pour se défendre et ne craignait personne.
Pourtant, alors qu’il se rendait avec son mulet, comme toutes les semaines au marché de la grande ville, Tarek fut intercepté par un groupe d’hommes du FLN qui l’attendaient en embuscade. Ligoté, il réussit à se détacher et au lieu de fuir, plongea dans le groupe d’hommes pour les attaquer à son tour. Il fut maîtrisé et assassiné dans la forêt, puis jeté dans l’oued tout proche. Son mulet et sa cargaison devinrent leur prise de guerre. Mokrane ne retrouvera jamais le corps de son cher frère et ne pourra donc jamais faire son deuil.
Au moment du drame, ce dernier taillait les oliviers sur ses terres.
Son père, les yeux rougis par les pleurs lui annonça la mort de son frère.
Il ordonna à Mohammed de sécher ses larmes et tous les deux repartirent en se soutenant mutuellement vers le village.
Derrière leurs fenêtres, les habitants scrutaient les deux hommes du regard. Tout le monde savait ce qui venait de se passer. La nouvelle s’était diffusée comme une traînée de poudre.
Mokrane était effondré. Son modèle, sa référence venait de mourir ! Lui qu’il croyait invincible.
Il s’isola dans les montagnes pour ne pas donner le spectacle de sa douleur.
Pourquoi son frère ne l’avait-il pas écouté ? Il lui avait pourtant maintes fois rappelé d’être prudent par ces temps tourmentés ?
En ruminant sa colère, Mokrane aperçut au loin la caserne de l’armée française qui dominait la vallée en se demandant s’il ne devait pas la rejoindre. Mais il avait peur. Que faire ? Se soumettre ? Se venger ? La loi du Talion lui revenait en tête.
Le soir même, il fit preuve d’un courage inhabituel et se rendit dans la maison du chef FLN local pour comprendre la raison de cet assassinat. En entrant dans la demeure, Mokrane découvrit un homme imposant assis en train de terminer de racler son assiette avec sa galette d’orge un reste de tomates pimentée à l’huile d’olive.
Le frère de Tarek avait les poings serrés et la gorge nouée. Il avait envie d’exploser et régler son compte à cet homme.
– « Pourquoi avez-vous éliminé mon frère ? » lui dit-il en serrant la mâchoire.
– « Il a osé défier notre loi, celle de pactiser avec les Français ! Voilà ce qu’il en coûte de trahir notre cause ! »
– « Mais, il n’était qu’un intermédiaire entre les habitants et les soldats ? »
– « Dis-toi qu’il l’a cherché ! Si tu oses encore pactiser avec eux, tu subiras le même sort ! ».
Puis cet homme bût d’un trait son verre d’eau frais tiré du puits. Mokrane crut devenir fou. Le silence devenait pesant. Il repartit, non sans lui avoir jeté un regard de haine. À l’extérieur, Il explosa et fondit en larmes.
En redescendant de la colline, les yeux rougis par les pleurs, il croisa une vieille dame, comme un signe du destin, qui l’interpella. On la surnommait dans le village la sorcière, car elle avait le pouvoir, paraît-il, de lire l’avenir. Mon père lui fit part de sa douleur face à la mort de son frère. Elle lui dit qu’il devait se battre, sinon qui se souviendrait de son nom ?
– « Tu es le seul garçon de la famille. Si tu meurs, ta lignée s’éteindra. Il faut te battre, vivre et tu auras des enfants. »
C’est pour Mokrane un électrochoc. Il fit part à son père de son choix et décidèrent d’un commun accord de se présenter le lendemain à la caserne française que mon père avait aperçue au loin. On y recrutait des sections de Harkas, mises en place par les autorités pour lutter contre le FLN.
Ils furent accueillis, à l’entrée de la forteresse, par un sergent arabe et un chien qui se mit à mordre Mokrane, enragé tout comme lui d’en découdre avec ces nouveaux ennemis.
Mohammed, trop âgé pour se battre, fut affecté à la garde de la caserne.
Mon père se retrouvait donc emporté dans les nombreux tourments de cette guerre.
Il apprit petit à petit la langue de Molière et fit connaissance de tous ses officiers qui prendront une place importante dans sa vie, dont le capitaine Louis.
Au fil des mois, il fit la preuve de son efficacité ; connaissant mieux que personne le terrain, les cachettes, il devint petit à petit le protégé des officiers qui l’appelaient « le petit Mokrane ». Un de ses chefs dira de lui plus tard qu’il n’avait jamais vu dans sa carrière, un homme si courageux et si futé pour débusquer l’ennemi.
On avait l’impression qu’il était protégé. Les balles ne l’atteignaient jamais. il était toujours en première ligne et savait se jouer des embuscades et des pièges. On était loin du chétif Mokrane. La mort de son frère l’avait transformé.
Des photos de cette époque nous seront données des années plus tard par un des chefs de Mokrane qui commandait sa Harka. Je découvrais mon père en photo couleur à l’âge de vingt ans et j’en fus bouleversé. La netteté des images étaient empreintes d’une réalité saisissante et donnait l’impression d’avoir été prises la veille.
On y voyait Mokrane revenir de patrouille, une autre assis sur un mur seul ou en train de préparer un mouton à la broche. À chaque fois, le même visage triste et fermé apparaissait, comme si la peine et la solitude avaient envahi cet homme à jamais.
En 1957, Mokrane se distingua par des faits de bravoure qui lui permettaient d’être militairement récompensé et d’obtenir le grade de sergent-chef.
C’est à cette époque qu’il fit la connaissance de cet officier Louis avec qui il noua des liens très forts. Cet homme droit sera toujours à ses côtés. Il savait qu’il pouvait compter sur Mokrane qui connaissait ses montagnes et le terrain par cœur.
En mars 1962, le cessez-le feu fut prononcé.
L’Algérie algérienne avait gagné. Le général de Gaulle, revenu au pouvoir en 1958 après son ambigu « je vous ai compris », donnait satisfaction aux soldats du FLN par le référendum d’autodétermination. Les harkis furent sommés de rendre leurs armes et retourner dans leurs foyers.
Dans le village, le drapeau vert et blanc flottait partout. Le bleu et le rouge de la France faisait pâle figure et brûlait dans les rues.
On signalait déjà des assassinats dans les forêts d’anciens supplétifs de l’armée française. La vengeance sournoise avait commencé. Ce fut une d’épuration.
Les « Marsiens (*) », appelés ainsi car ralliés à la cause algérienne en mars 1962, au moment où la France cédait le pays, étaient les plus zélés. Ils devaient prouver aux nouveaux maîtres du pays leur soumission, alors que quelques semaines auparavant, ils avaient choisi l’autre camp.
Durant la guerre, toute la famille avait été logée dans la caserne.
Elle devait maintenant rejoindre son village, car les soldats français allaient évacuer la forteresse. Tout le monde avait peur.
Louis permettait à Mokrane de garder son arme malgré les ordres du gouvernement français.
Entre temps, étaient nés dans la caserne les deux premiers enfants de Mokrane : Mabrouk en 1959 et Fatiha en 1961. La descendance était assurée. C’était une victoire pour mon père. La prédiction de cette vieille femme était donc vraie : le nom de la famille ne s’éteindrait pas…
Dans le village, mon père assistait à des règlements de compte. Tous les anciens Harkis furent recherchés par les nouveaux maîtres du pays.
Ils usaient de ruse pour les amener à se rendre. Ils promettaient de les laisser tranquilles à condition qu’ils donnent leurs armes. Ils les invitaient à les rejoindre à la mosquée pour parler et faire la paix. Mais, c’était la torture et la mort qui les attendaient. Les autorités françaises laissaient les meurtres se perpétrer au grand dam de Louis. Son honneur d’officier l’empêchait d’abandonner ses hommes.
On laissait tranquille mon père pour l’instant, car on savait qu’il était armé et dangereux. De toute façon, il ne voulait pas quitter ses terres, c’était catégorique. Sa femme Lila tenta de le raisonner et lui conjura de fuir en métropole. Il refusa.
Là encore, c’est cette même vieille femme qui allait faire basculer son destin. Elle lui fit savoir qu’elle avait entendue qu’on allait l’arrêter dans les jours qui viennent.
Il fallait se résoudre à partir.
Mokrane et sa famille étaient en danger.
Il fit savoir dans le village qu’il se rendrait le lendemain après-midi au marché du canton avec son mulet. Mais en fait, il s’enfuit dans la nuit pour rejoindre une caserne française à quelques kilomètres de là. Il prit avec lui son âne pour faire croire à un départ vers le marché.
Avant de partir, il indiqua à sa femme et ses parents qu’il les récupérera dans quelque temps avec une escorte de soldats.
Mokrane, sur la route, échangea sur la route son mulet à un ami contre un peu d’argent.
Une fois dans la ville, il trouva la caserne française et apprit que Louis son officier était encore présent. L’armée française se préparait à partir. Ce dernier le croyait déjà mort. Ils s’étreignirent de joie.
Mokrane resta quelques jours dans la forteresse où il retrouva quelques compagnons d’arme.
Quelques jours plus tard, Louis, son officier, prit une section et un camion militaire, chercher sa famille dans le village.
Les habitants furent surpris de voir Mokrane débarquer. Il emporta sa femme Lila et ses deux enfants. Ma mère n’eut pas le temps de saluer ses deux parents qu’elle ne reverra jamais.
Les villageois leur lancèrent des cailloux et leur crachèrent dessus. Il fallut bâcher le camion. Taous et Mohammed, les parents de Mokrane décidèrent de rester. « Le FLN n’oserait pas s’en prendre à deux personnes âgées », pensaient-ils. Et puis, il fallait s’occuper des terres de la famille et commencer la moisson de l’orge dans quelques semaines, car les grains, dorés au soleil, attendaient d’être cueillis.
Mokrane se promettait de revenir plus tard pour reprendre sa place et aider son père à récupérer la récolte.
Toute la famille fut emmenée quelques jours dans la caserne de la grande ville.
Louis trouva le moyen de les faire embarquer dans un bateau militaire contre les ordres officiels. Sa carrière risquait d’être compromise pour cet acte. Il prenait d’énormes risques pour mes parents.
La veille du départ, ils occupèrent une maison de colons français abandonnée, où un chien hurlait à la mort. Terrible spectacle que cet animal abandonné par ses maîtres. Comme une sorte de miroir déformant de la situation que vivaient mes parents.
Le port d’Annaba fut le lieu du départ. Louis avait pu sauver trois autres familles d’anciens Harkis. Mokrane les connaissait bien, puisqu’il les commandait pendant la guerre. Ils étaient devenus, malgré eux, des compagnons d’exil.
La traversée dura deux jours. Les pleurs, les hauts de cœur, le chagrin se mêlait à la découverte de l’inconnu.
Lila, qui n’avait jamais quitté son village découvrit la mer, et surtout la détresse humaine. Elle vit des femmes accoucher à même le bateau et devait sécher les larmes de son fils Mabrouk qui venait de voir s’envole sa casquette sur le pont.
Et puis, ce fut Marseille. Quai de la Joliette.
Pour la première fois, les compagnons d’infortune découvraient la métropole. Ce pays pour lequel ils s’étaient battus. Comment allait-on les accueillir ? Gaston DEFFERRE, le Maire de la cité phocéenne leur dit par voie de presse d’aller se faire réadapter ailleurs. Le LA était donné.
Ils furent quand même débarqués sur les quais, accueillis par la Croix-Rouge et emmenés dans un centre en banlieue de la ville. Louis avait tout organisé. Il fit transporter les trois familles dans une exploitation vinicole qui appartenait à son père : le domaine du Pradet à Toulon.
Mokrane retrouvait ici un peu de sa Kabylie. Il y faisait chaud et on y travaillait la vigne.
Quelques jours plus tard, une lettre parvint à l’exploitation. Elle émanait d’un cousin de la famille qui apprenait à Mokrane que son père Mohammed avait sauvagement été assassiné par le FLN. Ces derniers, n’ayant pu capturer le fils, se vengèrent sur un vieillard de 70 ans.
70 ans, c’était aussi l’âge où Mokrane se fit agresser en Lorraine en 2006. Triste coïncidence.
Mokrane connaîtra le déroulement de ce drame, plus tard, grâce à une personne qui était présente à ce moment-là avec son père. Il eut la vie sauve en feignant d’être mort. Il s’en tirera avec une oreille sectionnée. Ils emmenèrent mon grand-père Mohammed dans la forêt à l’abri des regards et le tuèrent avec des cailloux, pour le laisser ensuite mourir seul dans la nature.
Mokrane devint fou de rage à la lecture de cette lettre. La tragédie continuait. La mort appelait la vengeance. Cette malédiction ne s’arrêtait pas.
Il acheta une carabine chez l’armurier, qu’il installa dans sa maison pour se protéger craignant pour sa vie.
N’en pouvant plus d’attendre, il partit pour Marseille rejoindre deux de ses cousins arrivés là-bas. Ils avaient fui eux aussi, suite à la mort de leur frère assassiné par le FLN deux jours après le père de Mokrane. Ce dernier avait en tête de monter un groupe avec eux pour les venger.
Il prit le train seul, alors qu’il ne savait ni lire, ni écrire et retrouva après une journée de recherche dans toute la ville ses deux cousins très affaiblis dans un bar.
Après d’âpres discussions, Mokrane décida de remettre à plus tard cette vengeance et préféra rejoindre sa famille pour la protéger, en donnant l’adresse à ses deux cousins qui les retrouveront plus tard.
Les mois passèrent. Mokrane était comme un lion en cage.
Taous, sa mère, était la seule survivante de sa famille et à la merci du FLN. Elle pouvait à tout moment être exécutée.
Elle subissait, par procuration, la violence des villageois contre son fils le Harki absent. Mokrane lui envoyait de l’argent régulièrement qu’elle devait cacher, car on voulait lui prendre.
On obligea Taous à quitter sa maison et s’installer dans une sorte de niche au fond de sa cour, où elle avait juste le droit de manger quelques figues. Elle fit preuve de courage et se plaignit aux autorités locales qui la protégèrent.
Le frère de Lila vint la chercher plus tard à dos de mulet pour l’emmener chez lui. Elle n’emportera avec elle qu’une paire de ciseaux et une timbale. Cette dernière trône toujours dans la maison en Lorraine, comme une relique. Seul vestige récupéré de ce passé tumultueux.
Pendant ce temps à Toulon, les exilés apprirent que le gouvernement français proposait du travail dans le nord-est de la France. Il fallait de la main-d’œuvre dans les exploitations agricoles. Il fut alors décidé de partir dans cette direction. Tout le monde acquiesça.
Après des heures de voyage en train, les exilés débarquèrent dans cette nouvelle région. Le froid, le ciel gris, remplaçaient le son des grillons et la douceur méditerranéenne. Ils durent passer quelques jours en quarantaine à l’hôpital.
Lila emportera en souvenir une cuillère et une assiette aux couleurs de l’hôpital. Tout avait été laissé dans son village, elle n’avait plus rien, sauf deux couvertures et un vêtement pour son fils.
Les services de la Préfecture proposèrent aux infortunés rapatriés d’aller travailler dans une exploitation agricole à quelques kilomètres. Ils acceptèrent et comme une meute qui ne voulait pas se quitter, ils quittèrent l’hôpital.
Ce fut des mois de répit avant une nouvelle tempête qui s’annonçait.
Le patron de l’exploitation qui les embaucha avait été officier lui aussi. Les anciens Harkis ne manquèrent de rien. Ils pouvaient disposer de tous les légumes et de la viande qu’ils désiraient en échange de leur travail à la ferme. Lila s’y sentait en sécurité.
Mais, un membre du groupe avait entendu dire que Les fonderies de Longwy en Lorraine, recherchaient aussi de la main-d’œuvre. La France amorçait ses « trente glorieuses ». Il fallait de l’acier en grande quantité pour produire en masse.
Mokrane ne voulant pas quitter le groupe, décida qu’il les suivrait avec sa famille. Il craignait de rester seul. Le groupe le rassurait.
Pourtant, le patron de l’exploitation agricole les mettait en garde, car les fonderies de Longwy étaient souvent composées d’algériens fidèles aux idées du FLN et que les harkis n’étaient pas les bienvenus. On y signalait dans la presse des règlements de compte.
Mais, le départ fut quand même décidé.
Mokrane se retrouvait ouvrier dans l’immense bassin sidérurgique de Longwy, lui l’arboriculteur kabyle. Il vivait avec sa famille dans un village ouvrier fait de maisons en briques rouges caractéristiques de la région.
Le travail était rude et fatiguant, mais Mokrane l’exécutait avec rigueur.
Il réussit à intégrer une association d’Anciens Combattants où il assistait à différentes réunions patriotiques quelques soirs et les week-ends.
Dans la fonderie, on lui posait beaucoup de questions sur son passé. Mokrane restait évasif et très prudent. Il ne pratiquait pas le ramadan, ce qui mit la puce à l’oreille aux algériens qui travaillaient avec lui.
Un soir, une surprise inattendue attendait mon père.
Sa mère Taous, méconnaissable et semblable à une Indienne échappée de sa réserve débarqua sur le palier de la porte. Elle avait, grâce à des cousins, pris un avion et rejoint la maison de son fils en Lorraine ! Mokrane, très ému et heureux de retrouver sa mère saine et sauve, la questionna en détail pour connaître tous les épisodes de sa triste vie depuis la mort de son mari.
Mais, la joie de retrouver Taous allait être de courte durée.
Alors qu’il revenait d’une réunion, Mokrane découvrit que Lila avait été prise à partie par des algériens qui l’avaient insulté.
Sentant monter la colère encore très vive chez lui, il se rendit chez les fauteurs de trouble pour leur signifier qu’à la prochaine provocation, il ne répondrait de rien.
Nous étions en pleine fête de la ville. Les esprits étaient échauffés par l’alcool.
Le soir même, les cinq provocateurs avinés revinrent, armés de fourches, couteaux et pelles pour régler son compte à Mokrane. Ils entrèrent dans la maison, en présence des deux enfants Mabrouk et Fatiha, ainsi qu’un nouvel enfant baptisé Mohammed, né quelques semaines auparavant, qui portait le prénom du grand- père assassiné.
Mokrane reçut un coup à la tête. Il saignait beaucoup. Il recula et attrapa derrière le meuble sa carabine qui n’était chargée qu’avec une seule cartouche. Il tira et toucha une des personnes qui s’écroula au sol. Les autres détalèrent à l’extérieur. Lila avait caché les autres cartouches par peur du drame.
Les agresseurs attendirent devant la maison et lancèrent des cailloux. Mokrane sortit et fit semblant de recharger son arme. Les assaillants prirent la fuite.
Mon père, sûr de son bon droit, prit sa carabine sous le bras, embrassa sa femme, ses enfants tendrement pour se livrer à la gendarmerie. Sa fille de deux ans Fatiha, se mit à pleurer ne comprenant pas pourquoi son papa la quittait.
Il fut incarcéré jusqu’au procès, laissant Lila avec trois enfants et une vieille dame, seule et sans ressources.
Ma mère dût subir les intimidations des voisins qui avaient pris faits et causes contre Mokrane. Elle recevait des cailloux et des insultes à chacune de ses sorties.
Les mêmes scènes qu’en Kabylie se répétaient, toujours et encore.
On lui proposa, pour sa sécurité, de rejoindre des amis à Mont-Saint-Martin en Meurthe et Moselle. Elle accepta et quitta ce lieu funeste sans hésiter. Mokrane fut prévenu. Elle se promettait de venir le voir souvent.
La famille fut logée dans une cabane en bois attenante à une scierie, près d’un canal qui appartenait à une dame, veuve très influente de la ville qui pratiquait la philanthropie.
Elle se prénommait Raymonde et jouera un rôle fondamental pour la famille de Mokrane. Elle se prit très vite d’affection pour Lila qu’elle allait épauler en lui apprenant la langue et surtout les mœurs occidentales.
Ce geste fut pour Lila une éclaircie dans une vie émaillée de malheur depuis 1954.
Ma mère, livrée à elle-même, ne comprenant pas un mot de français, devait gérer trois enfants et une vieille dame en pleine dépression.
Raymonde lui rédigera toutes ses lettres administratives, mais surtout lui présentera des personnes clés dans l’intégration de la famille dans cette nouvelle ville.
Mokrane en prison à Longwy partageait la cellule avec deux autres détenus. Ces derniers lui proposèrent de s’évader avec eux. Mon père, sûr qu’il sortirait de prison pour légitime défense, refusa poliment la proposition.
Les gardiens découvrirent que Mokrane était seul dans sa cellule en l’ouvrant le jour d’après.
Le directeur de la prison le fit convoquer. Mokrane lui répéta ce qu’il avait déjà dit à ses codétenus.
Convaincu par son honnêteté, il lui proposa en récompense de devenir aide-cuisinier. Cette place était stratégique dans un établissement pénitentiaire, elle permettait ainsi d’exercer un certain pouvoir sur les autres détenus.
Au fil des semaines, Mokrane se plia à cette vie carcérale, en attendant le procès.
Les gardiens le prirent en sympathie. Il retrouva un ancien appelé qui avait servi dans la même compagnie que lui en Kabylie. Une amitié allait naître.
Mokrane avait une qualité essentielle qui deviendra une de ses armes : s’attirer les bonnes grâces de ses interlocuteurs. Son pouvoir de persuasion et d’empathie lui permettaient de se faire entendre et accepter. Nous l’appelions à la maison « le renard ». Il était aussi rusé que lui.
De son côté, Lila réussit à trouver un avocat grâce à l’aide de Raymonde qui la guidait et la conseillait.
Le procès se déroula quelques mois plus tard devant la Cour d’Assises de Nancy en octobre 1964.
L’affaire avait pris un tel retentissement dans la presse, que la salle d’audience était bondée, avec deux camps qui s’opposaient.
D’un côté des anciens rapatriés avec les drapeaux tricolores qui flottaient et de l’autre des sympathisants du FLN et de la famille du décédé.
La tension était palpable et reflétait l’état d’esprit de la France, deux ans après l’indépendance.
Une étincelle aurait pu faire tout exploser.
Les forces de l’ordre, nombreuses, tenaient les protagonistes à bonne distance.
Durant ces deux jours de procès, l’avocat de Mokrane rappela toutes ses péripéties : l’assassinat de son oncle en 1955, de son frère en 1956, de ses deux cousins et de son père en 1962. Le public fut ému par l’énoncé de cette suite de drames.
Mais la touche finale qui allait donner l’avantage à Mokrane fut le témoignage de son officier Louis. L’uniforme, la voix, les décorations et le charisme de son chef finirent de convaincre le jury populaire.
Mokrane était libre ! Il fut acquitté pour légitime défense. Des youyous de joie, des applaudissements résonnaient de la salle d’audience.
Mokrane serra très fort Lila et ses trois enfants qu’il n’avait pas vus depuis des mois. Il obtenait enfin Justice sans devoir recourir à la violence. La Loi reprenait enfin sa place.
Il était loin le chétif garçon des montagnes kabyles qui s’effrayait de tout. La guerre, les épreuves l’avaient endurci. Son état d’esprit était tout autre. Personne ne pourrait plus le provoquer.
Le groupe rejoignit le véhicule et roula vers Mont-Saint-Martin où les attendait un bon couscous préparé Par Lila. Louis les accompagna pour lui aussi participer à ce festin libérateur.
Mokrane allait découvrir cette nouvelle ville d’adoption de l’Est de la France. Lui l’arboriculteur, le paysan. Tout était à reconstruire maintenant dans ce nouveau lieu.
Il fit, à son tour, la connaissance de Raymonde qui lui donna très vite des adresses d’amis susceptibles de l’employer.
Mokrane dut acheter sa première mobylette pour se rendre à un nouveau travail à quelques kilomètres de sa ville.
Cette maison dans laquelle mes parents se trouvaient fut baptisé par nous plus tard « la vieille maison ». Elle était tellement insalubre que c’était le seul nom que nous lui avions trouvé. En bois, mal isolée, les rats partageaient notre vie.
Quelque temps après, nos colocataires de fortune, décidèrent de quitter ce lieu pour une HLM plus moderne dans la même ville.
Nous allions enfin être seuls.
La vie reprenait ses droits et les mois passèrent. La famille s’agrandissait.
Bachir naquit en 1965, Louis en 1966 qui portait le même prénom que l’officier de Mokrane, Geneviève en 1967, le prénom de sa femme, moi en 1968, suivi de David en 1970 et Jacques en 1971.
Ce lieu devenait pour nous les enfants notre territoire exclusif. Gare à ceux qui osaient s’aventurer chez nous ! Nous ressemblions à des gitans. C’est du moins l’image que nous devions renvoyer aux personnes extérieures qui nous regardaient.
Grâce à l’école, mes frères réussirent à se créer, petit à petit, un cercle d’amis fidèles qui allaient devenir de solides appuis pour l’acquisition de notre notoriété au sein de cette ville d’adoption.
Mon frère Mohammed en particulier, passionné par les animaux, fit la connaissance à l’école du fils d’un des plus gros propriétaires terriens de la ville, Philippe, avec qui il lia une amitié profonde et sincère.
Tous les deux passaient la plus grande partie de leurs journées en concours hippique. Mon grand frère se retrouva transporté dans le monde de l’équitation, pour en faire plus tard son métier.
Mais c’est surtout grâce à cette famille que peu à peu mes parents vont voir leur cercle de connaissance s’élargir.
Ma mère Lila prit l’habitude de leur préparer ce qu’elle savait faire le mieux : son traditionnel couscous.
En échange, nous recevions des compensations, comme le droit d’aller chercher des fruits dans leurs vastes propriétés, pour nourrir la famille, ou bénéficier d’avantages dans différentes institutions de la ville.
Mais, dans le quartier, tout le monde ne voyait pas d’un bon œil notre arrivée.
Nous étions considérés, par beaucoup, comme de vulgaires immigrés venus « manger le pain des Français ».
Fort heureusement, de bonnes âmes seront toujours présentes pour mes parents.
Louis, l’officier de Mokrane qui les protégera de la mort en les aidant à fuir, Raymonde qui a tendu la main à Lila en lui fournissant un toit et des conseils.
Cette femme sera la pierre angulaire, la clé de voûte à toutes les rencontres que feront mes parents.
Maître Austry, notaire dans la ville, ami de Raymonde, qui proposera à mes parents d’acquérir un terrain pour la construction du pavillon à un prix très avantageux. Cet officier d’état-civil avait pris mes parents en amitié.
Issu d’une grande famille du sud-ouest, cet homme de conviction à l’accent rocailleux, était un cousin du grand Jean-Jaurès. Sa femme m’avait d’ailleurs raconté un épisode concernant le député de Carmaux.
Ce dernier ayant pris la défense des mineurs de cette ville à la fin du 19e siècle, lui valut la colère de sa mère qui lui interdit de remettre les pieds dans la maison familiale. Étant issu d’une famille traditionnelle chrétienne de droite, elle ne comprenait pas que son fils ait pu prendre la défense d’ouvriers.
Maître Austry avait pour les Harkis une affection particulière et s’était ému du sort qu’ils avaient subi après 1962. Son épouse, très impliquée dans le monde associatif et religieux de la ville permettra, par son influence, à ma grand-mère Taous d’être enterrée religieusement dans une église lors de ses funérailles en 1990.
Ils seront toujours pour nous des amis fidèles. Ils assisteront à tous les repas organisés à la maison et partageront de nombreuses fois le couscous et le méchoui préparés par mes parents.
Ma grand-mère Taous, elle aussi, avait vécu à sa manière la douleur de l’exil.
Je la voyais tous les jours pratiquer ses prières et implorer le Tout Puissant de protéger son fils et son mari disparus. Lorsqu’un cousin ou un oncle venaient à la maison, elle implorait qu’on l’emmène avec eux. Elle voulait retourner dans son village, regrettant d’avoir fait le voyage en France. Mais Mokrane refusait à chaque fois. Il craignait pour sa vie et voulait la protéger.
Durant toute notre enfance, elle s’est toujours occupée de nous. Ne parlant pas français, nous avons pu nous familiariser avec la langue kabyle. Elle nous chantait des berceuses ou entamait des conversations avec nous. Elle veillait à notre sécurité et n’hésitait pas à demander l’aide à son fils Mokrane lorsqu’elle était en difficulté avec nous. Sa jambe gauche la faisait boiter et souffrir depuis toujours. Je racontais à mes camarades qu’elle avait été touchée par une balle pendant la guerre, pour donner du relief à notre histoire.
La famille s’agrandissait encore. En 1974, naquit Catherine, Marie-Louise en 1975, Stéphane en 1977 et enfin Laurent en 1979.
L’école allait devenir pour nous, les enfants, le lieu de notre intégration à la française.
Les instituteurs de l’époque eurent à tous nous connaître du fait de nos âges rapprochés. La discipline que faisait régner mon père à la maison l’était aussi en classe. Nous devenions des modèles de sagesse et de respect pour les professeurs qui nous prenaient en exemple.
Nous répétions en classe les erreurs syntaxiques de nos parents du fait de leur maîtrise insuffisante de la langue. Nos maîtres se chargeaient de nous corriger, quelquefois avec vigueur.
Dans les années soixante-dix, l’école restait encore composée d’instituteurs de la « vieille école ». La blouse était de rigueur, la mixité venait juste de s’installer, la plume Sergent Major vivait ses dernières années. Mais la discipline restait ferme. J’ai souvent fait l’expérience de la règle sur les doigts ou des cheveux tirés derrière les oreilles.
Mais, la pire des humiliations pour moi, fut celle de devoir me promener avec ma copie et mon zéro pointé collés sur le ventre. J’avais l’obligation de faire le tour de la cour, le temps de la récréation, les mains dans le dos avec le bonnet d’âne sur la tête.
Pour tenter de remédier à nos lacunes, certaines de nos institutrices venaient à la maison tous les mardis soir, donner des cours de rattrapage gratuitement.
Dans la cour de l’école, certains élèves nous insultaient, sans rien savoir de notre Histoire. Mais nos grands frères nous défendaient et s’occupaient de régler les différends par de mémorables bagarres à la sortie.
Peu à peu, on commençait à nous respecter et à nous craindre.
En 1974, grâce aux salaires réguliers de Mokrane, nous quittions notre « vieille maison » pour un pavillon moderne à quelques pas de cette dernière. Le terrain nous avait été trouvé par Maître Austry. Lors du creusement des fondations, la grue déterra trois obus de la première guerre mondiale. La guerre, la violence étaient bien au cœur de notre Histoire ! elle venait se rappeler à notre bon souvenir.
Nous goûtions enfin au progrès !
Des toilettes intérieures, des chambres vastes et une cuisine moderne au gaz. Ce fut pour mes parents une première victoire, eux qui avaient tout perdus en Algérie. Ils devenaient enfin propriétaires !
Le terrain attenant à la maison était important. Mokrane y fit son jardin et accueillit ses premiers animaux. La vie semblait reprendre peu à peu ses droits, après des années de malheur.
Quelques mois plus tard, le terrain en friche qui se trouvait à côté de notre maison fut acheté par un couple avec un enfant. Ce dernier allait devenir comme il le dira plus tard notre quatorzième frère.
Franck nous aborda un jour, en s’asseyant sur le muret de séparation entre sa maison et la nôtre, comme s’il voulait passer une frontière. Naturellement, nous nous approchions de lui et fîmes connaissance. Blond, les yeux bleus, jovial et joueur, il nous plut tout de suite.
Son père était un chef d’entreprise connu pour son austérité. Nous l’entendions souvent pester contre ses ouvriers. Il était craint et respecté.
Mais, il avait deux passions qui nous le rendait sympathique : la musique et le monde du cirque. Clown auguste dans un duo très professionnel, c’était une tout autre personne que nous découvrions à ce moment-là. Il était métamorphosé. L’austère patron d’entreprise n’existait plus.
Nous passions ainsi nos fins de semaines à le regarder répéter dans son garage avec son complice M. Lambert qu’il appelait pour les besoins du spectacle M. Camembert.
Nous étions son public test. Nous attendions avec impatience tous ses spectacles pour rire et applaudir à ses pitreries, même si nous connaissions par cœur ses répliques.
Tous les jours, nous l’entendions jouer de la trompette, de la cornemuse ou du piano dans son sous-sol.
Dans notre rue, malheureusement, nous subissions la haine d’un couple qui détestait mes parents. Tous les jours, lorsqu’ils passaient devant la maison, ils se mettaient à cracher sur la porte ou nous insultaient.
Nous redoutions que mon père s’emporte et reproduise le drame de Longwy. Mais il sut se contenir. Par contre, ma mère avait du mal à garder son calme, mais faisait toujours bonne figure pour ne pas nous inquiéter.
Cette famille comprit avec le temps que nous n’étions pas l’image qu’ils voulaient donner de nous. Grâce à l’école bien sûr, mais surtout aux résultats sportifs qui commençaient à apparaître dans la presse.
Notre nom de famille prenait souvent place dans la rubrique sportive et non pas celle des faits divers.
Quelle ne fut pas ma surprise de les croiser voilà quelque temps et de constater le changement de comportement à mon égard. Ils en étaient presque à pleurer d’émotion en me retrouvant, comme si j’étais un de leurs enfants. J’en fus stupéfait.
Le sport fut un des leviers de notre « respectabilité ». Mon père nous obligea tous à pratiquer une activité qu’il avait choisie pour nous : la gymnastique sportive.
Mes frères devinrent des champions. Les coupes, les médailles, les articles de journaux élogieux, tapissaient la maison. Mais, contrairement à mes frères, ce sport devenait une contrainte. J’avais Gym tous les jours sauf le jeudi. Je n’avais pas la prouesse de mes frères et j’étais plutôt froussard. Mais Mokrane m’obligea à continuer jusqu’à 13 ans. Au club, j’étais souvent pris comme la victime par mes camarades et je subissais leur méchanceté.
Un soir, une bagarre eut lieu à la fin de l’entraînement avec un garçon qui se moquait de moi. Je subis une défaite cuisante. Ce fut le signal pour mon père qui comprit que ce sport ne me convenait pas. J’étais délivré !
Mais la délivrance pour Mokrane était loin d’être acquise avec son passé.
Même si les années s’égrainaient, mon père n’oubliait pas les drames de « sa » guerre d’Algérie. Son jardin, ses animaux, son travail d’ouvrier lui occupait l’esprit, mais, il parlait souvent de son Histoire. Nous savions qu’elle était au cœur de ses préoccupations. Il nous racontait régulièrement l’épisode de la mort de son frère et à chaque fois il fondait en larmes.
Cette blessure n’était toujours pas apaisée. Il n’avait pas fait le deuil.
Je le constatais lorsque nous regardions ensemble les westerns ou les films d’actions à la télévision.
Dès qu’une scène de bagarre se déroulait, je voyais Mokrane serrer les dents et les poings, prêt à bondir dans l’écran comme s’il voulait prendre part au combat.
Que se passait-il dans sa tête ? Revivait-il les embuscades et les combats ? La mort de son frère ?
Les questions restaient sans réponses pour moi le jeune adolescent qui découvrait petit à petit cette tragédie qui prenait forme dans mon esprit de manière confuse.
Nous étions pris entre deux discours :
- D’un côté Mokrane qui nous persuadait que nous étions de « vrais français » et que le prix du sang avait été payé par notre famille pour ne pas rougir de notre place ici.
- Puis, de l’autre, certains Français qui nous prenaient pour des immigrés qu’il fallait stigmatiser. Difficile de trouver sa place lorsqu’on a treize ans.
Mon père nous rappelait tous les week-ends son drame par son active implication à son Association d’Anciens combattants.
Il y occupait la fonction de porte-drapeau et responsable de la section Harki. Pierre Casazza, son Président, était un ancien appelé en 1956. Il avait vécu aux côtés de soldats Harkis et connaissait leur drame. Une amitié s’était créée entre ces deux hommes.
Mokrane se rendait inlassablement de défilés en défilés avec son drapeau et ses médailles qu’ils portaient fièrement, comme pour afficher aux yeux de tous sa douleur et le sacrifice de sa famille. Ce fut une sorte de pénitence.
Je connaissais par cœur les rituels Patriotiques et j’assistais aux discussions enflammées que tenait mon père au vin d’honneur avec ses compagnons d’arme. Je rêvais de devenir militaire et même musicien. J’étais comme envoûté par cet univers.
À cette époque, mes frères et sœurs et moi-même, ne comprenions pas tous les ressorts de ce drame. Mokrane nous rappelait sans cesse de nous méfier de tout, de ne faire confiance à personne. Lui qui avait échappé maintes fois à la mort, il vivait comme un fugitif. Il se disait lui-même un survivant.
Il n’avait qu’à moitié tort. Il suffisait pour cela de lire les articles de journaux dans les années soixante-dix relatant les assassinats et les règlements de compte sur le territoire français entre pro-FLN et anciens Harkis.
La guerre s’était exportée en France.
Mon père avait jusqu’à une date récente, un port d’arme octroyé par la Préfecture, car sa vie pouvait être mise en jeu.
Ma mère se méfiait lorsqu’une voiture ralentissait devant la maison ou qu’un appel téléphonique retentissait. Ne jamais donner notre adresse ou notre numéro de téléphone étaient nos consignes. Ils étaient tous les deux encore empreints de peur et craignaient pour leurs vies. Ils nous ont transmis leur angoisse.
Il faut dire aussi que mes parents ont eu du mal à intégrer les mœurs de la vie occidentale, eux les arboriculteurs kabyles, habitués à vivre dans ces villages clos traditionnels où les coutumes ancestrales étaient encore très présentes.
Ce sont les filles de la maison qui eurent le plus à en souffrir.
Mon père voulait qu’elles soient élevées à « l’algérienne. » Ma grande sœur Fatiha en subira les conséquences. Brillante élève, elle remportait tous les honneurs et obtenait le Baccalauréat haut la main. Souhaitant faire des études supérieures, mon père s’y opposa, estimant qu’elle devait rester à la maison pour aider sa mère. Elle en fut blessée.
Je devais l’accompagner à toutes ses sorties. Pour le permis de conduire, sur le marché ou en ville. J’étais son garde-du-corps bien malgré moi. Je me soumettais à mon père et devais obéir sous peine de punitions. Aucun garçon ou prétendant ne devaient l’approcher sans l’autorisation de mon père que je représentais.
Mes trois autres sœurs eurent plus de chance. Les années aidants, mon père avait compris, petit à petit, que la France n’était pas l’Algérie. Il fallait que ses filles puissent vivre comme les autres. C’était sa manière de nous intégrer à cette France métropolitaine.
Elles purent sortir librement et même lui présenter des garçons ! Ce fut chez nous une Révolution ! Je ne peux blâmer mes parents. Personne n’a pu leur expliquer les choses à l’époque. Il fallait qu’ils fassent leurs propres expériences.
Malgré tous ces drames, j’ai eu une enfance heureuse. Mes parents ont toujours été aimants. Ils se sont sacrifiés pour nous. Nourrir treize enfants n’a pas toujours été facile.
Lila nous donnait en plus du souper le soir, un bol de chocolat avec des tartines pour être sûr d’avoir le ventre bien rempli. Elle avait peur que nous manquions.
Ma mère était une cuisinière accomplie. Ses plats régalaient la famille et les amis. Son couscous avait acquis une réputation départementale. Elle devait préparer très souvent ce plat pour remercier tous nos bienfaiteurs de la ville. On lui fournissait la viande et elle se mettait au travail. Lila ne quittait jamais sa cuisine. C’est ce qui explique que, devenus adultes, nous soyons tous devenus amoureux de la bonne cuisine et des petits plats mijotés. Notre mère nous a transmis cette valeur.
Franck, notre voisin, profitait aussi des largesses culinaires de Lila.
Il était très souvent à table avec nous. Il découvrit tous les plats traditionnels de Kabylie et en redemandait : berkoukès, thifrerine, larswen, sfeung, tous ces noms résonnaient dans sa tête comme une tirade de Ragueneau dans Cyrano de Bergerac.
Grâce à leur jardin, mes parents vivaient presque en autosuffisance. Il fallait cela pour nourrir toute la famille. Mokrane cultivait des légumes qu’il produisait à profusion et avait même reçu en cadeau de ses services, un second jardin où il se mit à cultiver des hectares de pommes de terre.
Ce qui nous rendait furieux à cette époque, nous les enfants, c’était la garde des moutons.
Mokrane souhaitait nous rappeler à travers cette corvée nos origines de berger kabyle.
Pour cela, il avait acheté des brebis. Cela permettait aussi d’avoir toujours de la viande en grande quantité à disposition.
Tous les soirs après l’école, nous devions nous rendre impérativement dans une pâture près de la maison et avions pour tâche d’emmener paître les ovidés l’herbe tendre de la prairie.
Nous préférions grimper dans les arbres et jouer aux soldats. Quelquefois, nos animaux échappaient à notre vigilance et s’enfuyaient sur la route, ou se retrouvaient dans les jardins de nos voisins. Nous recevions des corrections une fois rentrés pour notre manque d’attention.
Mais le drame survint lorsqu’un de nos béliers tomba dans le fossé tout proche et se noya. Le poids de sa laine l’empêcha de remonter. Mon père contre toute attente ne nous réprimanda pas. Nous l’avions échappé belle.
Cette pâture était notre territoire, notre domaine exclusif. Nos amis agriculteurs nous autorisaient à y jouer et à y mettre notre bétail. Malheureusement une famille d’éclusiers toute proche venait souvent y faire des incursions, tel Attila, et profiter d’un énorme cerisier qu’ils pillaient en quelques jours.
Cela fut le prétexte à déclencher dans nos yeux d’enfants des combats héroïques. Nous préparions des embuscades, des pièges.
Un conflit digne de « la guerre des boutons » qui nous amusait et devenait un jeu. La pâture se transformait en champ de bataille.
Cela me permit de découvrir avec eux l’univers de la batellerie et des éclusiers.
À cette époque, les écluses étaient encore souvent manuelles.
Nous aidions le technicien de l’écluse à faire passer les péniches ou les bateaux de plaisance.
En échange, nous recevions des seaux de blé ou de maïs pour nos animaux que nous prenions dans les péniches qui les transportaient. Les yachts hollandais, suédois ou anglais qui passaient l’écluse nous faisaient voyager par la pensée.
Le canal devenait notre piscine municipale, notre lieu de vacances en été pour nous rafraîchir, car le peu de moyens de mes parents nous empêchaient de profiter de la mer ou de la montagne. J’attendrai ainsi 47 ans avant de connaître les joies des sports d’hiver.
C’est dans ce canal que mon père nous apprenait à nager en utilisant « sa méthode » : nous attacher à une corde autour de la taille et nous jeter à l’eau. Après quelques « tasses », nous flottions et nagions sans problème.
Ce lieu devenait incontournable dans notre vie. Tout ce qui se déroulait le concernait de près ou de loin. Expéditions en bateau gonflable, pêche aux poissons et aux écrevisses que nous faisions cuire dans une casserole et que nous dégustions. Nous étions de véritables « Robinson », heureux d’être là.
Je me suis toujours senti français au plus profond de moi.
Des personnes m’ont quelquefois rappelé quand même d’où je venais lorsque j’avais tendance à l’oublier. Il s’agissait de mots, de postures, de sous-entendus, de moqueries.
Nous étions pour beaucoup, des « Français de papier ou d’importation ». J’avais beau expliquer que mon grand-père avait fait Verdun, que j’avais eu mon oncle, mes deux cousins et mon grand-père assassinés et Morts pour la France, rien n’y faisait. J’allais même parfois, lorsque ma colère montait, prendre les médailles de mon père et les montrer à ceux qui ne comprenaient pas.
Comment expliquer à des enfants une histoire si complexe ? L’école ne nous y aidait pas beaucoup. Les livres d’Histoire très orientés, ignoraient le drame des Harkis. Ils donnaient une image souvent négative de l’Armée française où torture, violence étaient les deux seuls mots pour résumer cette guerre qui était beaucoup plus complexe.
Il fallait se cacher, ne pas dire que nous étions des enfants de Harkis au risque de nous faire insulter ou violentés.
Au moment de mon adolescence, ce que je craignais le plus (à part les filles) c’était les réunions parents-professeurs. Mokrane voulait toujours y aller. J’avais honte de son accent, de ses fautes de syntaxe et de son manque de culture lorsqu’il était face à mes professeurs.
La discipline était sa valeur cardinale, son credo. Mon père rappelait sans cesse de ne pas hésiter à nous tirer les oreilles si nous ne nous tenions pas bien en classe. Il fallait soigner les apparences comme en Kabylie, ne pas faire honte à la famille.
À la maison, mes parents ne sachant ni lire, ni écrire, c’était mon grand frère Mabrouk qui lisait nos bulletins scolaires.
Nous passions chacun notre tour, en file indienne, présenter nos résultats et malheur à ceux qui avaient des appréciations négatives ! Nous recevions une fessée bien sentie. Avec l’habitude, nous préparions ce moment en rembourrant nos vêtements pour amortir les chocs. Nous en riions tous ensemble. Cela devenait un jeu entre nous.
Les années passèrent. Nous grandissions dans cette ville et notre histoire était maintenant connue de presque tous. Notre nom de famille était synonyme de « bien élever, propre, respectueux ». La bascule se faisait petit à petit.
Nous devenions « honorables ».
Mokrane et Lila pouvaient se vanter d’avoir réussi à reconstruire une nouvelle vie en métropole et élever treize enfants dans l’Honneur et le respect.
Mes parents ayant toujours tout fait pour que notre intégration soit la plus parfaite, allèrent jusqu’à nous faire baptiser, communier et confirmer. Je l’ai inauguré dans la famille, jusqu’à devenir enfant de chœur tous les dimanches, à servir M. l’Abbé à la messe.
Rôle que je tenais tellement à cœur que mes frères et sœurs me surnommèrent « frère Marc ».
On ne pouvait pas faire mieux pour s’intégrer dans cette France qui avait du mal à comprendre notre chemin de vie. Nous étions devenus des cas d’école, des exemples pour les habitants de la ville, presque des bêtes de foire quelquefois.
Toute ma vie, j’ai dû prouver que j’étais bien français. A l’école, dans le sport, dans mon travail.
Un combat épuisant et qui montre à quel point ce drame de la guerre d’Algérie a laissé des traces sur nous les enfants.
Français ou algérien ? Traître ou héros ? Victime ou bourreau ?
Certains épisodes de ma vie me rappelaient ce cruel dilemme.
Vers l’âge de 19 ans, je prenais l’habitude de sortir avec mes amis et la discothèque était le lieu incontournable du week-end pour la jeunesse de l ‘époque.
Je craignais ce moment, car le portier m’interdisait régulièrement l’entrée au seul prétexte que je n’avais pas le bon faciès.
J’en étais profondément humilié. « Mes amis », au lieu de protester et me défendre, se dépêchaient d’entrer pour s’amuser et me laisser seul avec mon chagrin et surtout ma colère.
J’essayais en vain prouver au portier, pourtant maghrébin, ma bonne foi, mon intégration réussie, mais rien n’y faisait. Ma carte d’identité, mon permis de conduire que je sortais sur la table violemment ne changeaient rien. Je restais seul, sous le regard des clients qui entraient en groupe et rigolaient de ma situation. A l’époque, je n’avais pas les mots pour me défendre, répliquer, argumenter.
Aujourd’hui, mes frères et sœurs ont plus ou moins réussis leur vie sociale. Ils ont construit une famille, fait des enfants. Mes parents sont très fiers. Ils sont devenus arrières grands-parents deux fois.
Mokrane, qui se retrouvait seul à la mort de son frère Tarek, a conjuré le sort : avoir une descendance.
Mais ce drame est encore présent dans notre inconscient. Une sorte de bombe nucléaire qui a explosé en 1954 et qui continue de nous irradier à des degrés différents.
Le métier que j’exerce n’est pas un hasard. Je suis professeur d’Histoire-Géographie dans un lycée. L’Histoire est bien au cœur de notre famille. Une Histoire mouvementée, cruelle et en même temps salvatrice.
Salvatrice, car je me suis rendu avec Lila en 2007 dans le village de mon père où se sont déroulés ces drames. J’y ai découvert un village encore imprégné par ce passé et une population vieillissante où la jeunesse semblait désorientée.
Mes parents avaient-ils fait le bon choix de partir ? Que serions-nous devenus si nous étions restés là-bas ?
L’Algérie fête ses 58 ans d’indépendance. Le FLN est toujours au pouvoir depuis cette date. Abdelaziz Bouteflika n’est plus qu’une ombre, une image. Le peuple réclame des réformes, mais l’Armée tient toujours les rênes du pays. Mon père s’est battu pour garder sa Liberté. Comme on dit chez nous, il a eu le « nif ».
Mokrane a essayé plusieurs fois de retourner sur la terre de ses ancêtres, là où tout avait commencé. En 1984 et 1986.
La première fois, il s’y était rendu avec deux de mes frères. La tension était extrême pour nous. Allait-il se faire arrêter ? Assassiner ?
En débarquant à la douane, les douaniers le mirent de côté et le questionnèrent. Il avait encore une fiche de police à son nom à l’aéroport !
Pourquoi revenait-il ? Que comptait-il faire au pays ? Voulait-il commettre un attentat ? Il resta une nuit en prison à l’aéroport, puis fut contraint de reprendre l’avion.
En rentrant, il écrivit une lettre au Président de la République François Mitterrand qui lui promit en retour qu’il allait faire le nécessaire. Un article fut même publié dans le journal Le Monde.
En 1986, Mokrane put enfin fouler le sol de sa terre. Décidément le chiffre 6 était pour mes parents un chiffre fétiche.
Il retrouvait dans son village ce qu’il avait laissé quelques années auparavant.
L’émotion fut intense. Tous les événements douloureux de cette période resurgissaient : les combats, les peurs, les rires, la camaraderie de ses frères d’armes, la mort de son frère.
Mon père retrouva aussi la ferme familiale. Elle était restée telle qu’il l’avait laissé en partant. Personne ne l’occupait, à part une cousine qui y mettait ses moutons. Tout était figé, comme si le temps s’était arrêté. Il se souvenait de cette orge qui n’avait jamais pu y être moissonné. Le terrain qui accueillait autrefois cette céréale était devenue une forêt. Il se mit à pleurer d’émotion.
Sa famille lui fit un accueil chaleureux, mais certains habitants se cachèrent en le voyant, car ils le craignaient encore. Mon père était surnommé le Lion dans le village.
Mokrane a maintenant 85 ans, au moment où est écrit ce livre. Il continue de ressasser ce passé qui ne passe pas. La vieillesse, loin de l’apaiser, semble au contraire accentuer son ressentiment. La mort de son frère reste une blessure qui ne se referme pas. La moindre conversation avec lui le ramène inlassablement à sa guerre d’Algérie. Il parle de ses souffrances, de la violence des combats et des injustices subies.
Il n’a pas réussi à dépasser cette histoire qui la suivra jusqu’à sa mort.
En 1996 (encore un 6), Mokrane reçut la Légion d’Honneur de la main de son lieutenant de l’époque, qui était devenu entre-temps Général de corps d’Armée de la Région de Bordeaux. Il s’est enfin senti reconnu, lui l’arboriculteur kabyle qui ne savait ni lire, ni écrire. On lui reconnaissait enfin officiellement sa douleur.
Quatorze enfants dont une décédée, douze petits-enfants, deux arrière-petits-enfants. Mokrane et Lila ont réussi à surmonter les 44 épreuves et construire une nouvelle histoire en métropole. La vieille sorcière de Kabylie avait donc raison.
Mohammed son père et Tarek son frère, n’ont jamais eu de sépultures. Nous avons pu faire inscrire à Perpignan leurs identités grâce à une association qui a créé « le Mur des disparus d’Algérie », où figurent 619 noms de personnes décédées et dont les corps n’ont pas été retrouvés. Mokrane s’y rend quelquefois et peut enfin déposer des fleurs sur une stèle en marbre. Un réconfort qui l’apaise.
Même si l’orge n’a pas été moissonnée en juin 1962, la nouvelle graine qui a germée en France s’est développée et a fait de nouveaux rameaux plus vigoureux.
C’est l’histoire de la Vie où les épreuves nous construisent et nous rendent plus forts.
- À nous maintenant de transmettre cette Histoire à nos enfants et petits-enfants pour ne jamais oublier le sacrifice de mes parents et les drames de cette guerre.
Marc ASSOUS
"Marsien" ?
Cette appellation désigne les combattants qui ont rejoint tardivement le conflit algérien en 1962 et notamment dans les derniers mois, entre le 19 mars : l'entrée en vigueur du cessez-le-feu des accords d'Évian, et la proclamation de l’indépendance en Algérie : le 5 juillet.