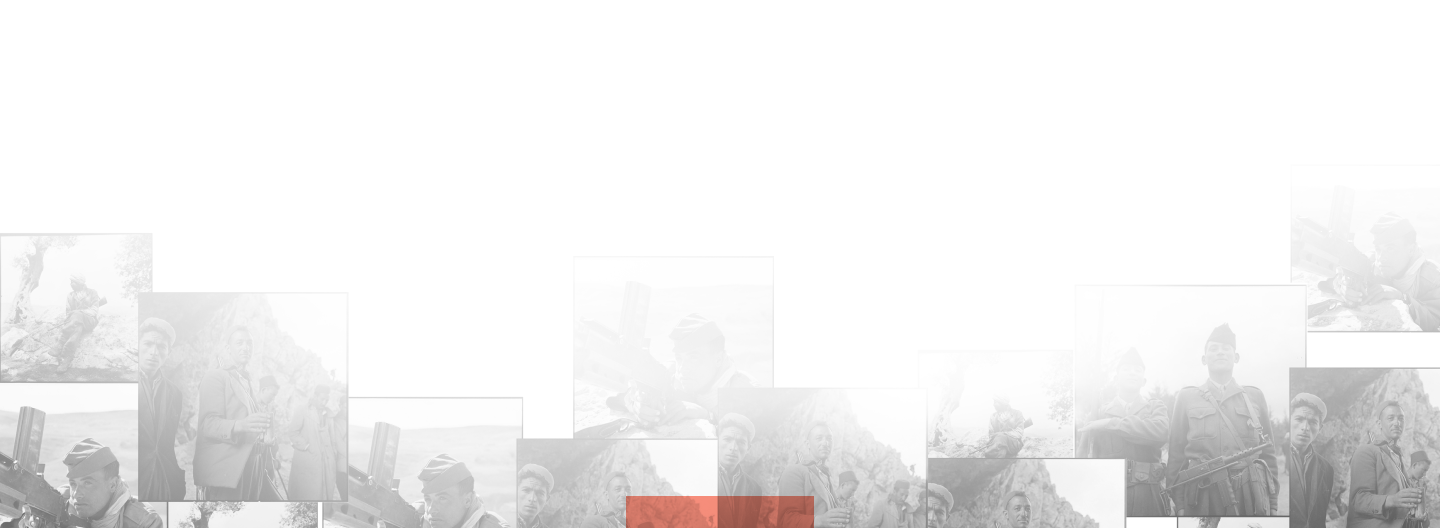Les Harkis, un destin tragique et singulier
De l'invisibilisation à la reconnaissance et à la réparation.
Cette fiche de présentation générale a une visée pédagogique non exhaustive. Pour plus de détails sur l’histoire des Harkis, les ressources utilisées sont citées en fin de page.
Introduction
De l'invisibilisation à la reconnaissance et à la réparation
Si les Harkis sont devenus progressivement un enjeu de politique locale et nationale, leur sort a longtemps été invisibilisé, préempté par des tiers porte-parole. Arrivés sur une terre inconnue, dont ils ne maîtrisaient souvent pas la langue, il fallut attendre la deuxième génération pour que, à partir des années 70, la question harkie s’insère dans le débat public.
Les Harkis se sont emparés de leur propre parole jusqu’à devenir un groupe de pression actif et efficace. S’en sont suivies des déclarations et des actes des Présidents de la République successifs, de la reconnaissance de leur engagement et de leurs souffrances sous Jacques Chirac, à la reconnaissance de la responsabilité de la France sous Nicolas Sarkozy et François Hollande, et à la demande de pardon formulée par Emmanuel Macron.
Les Harkis et leurs descendants (entre 900 000 et 1 million de personnes) forment aujourd’hui un tissu associatif aussi dynamique qu’éparpillé entre quelques 200 associations, dont une minorité exerce une activité régulière.
I. Les Harkis avant 1954
L’histoire des supplétifs algériens prend racine dès le début de la conquête coloniale (1830) : intégration à l’armée régulière ou supplétifs, majoritairement issus de territoires ruraux.
Ils combattent aux côtés de la France durant les deux guerres mondiales. L’histoire des supplétifs prend un tournant décisif avec la guerre d’Algérie.
II. Les Harkis durant la guerre d’Algérie (1954-1962) : typologie
La guerre d’Algérie commence au lendemain de l’insurrection du 1er novembre 1954 organisée par le Front de libération nationale (FLN) et son bras armé l’Armée de libération nationale (ALN).
Recrutement de supplétifs = un atout considérable pour la France :
Endiguer la baisse drastique des effectifs suite à la 2de G.M. et à la guerre d’Indochine.
Bénéficier de leur connaissance fine du terrain : atout militaire.
Bénéficier de leurs connaissances linguistiques (arabophones et berbérophones) : appui avec la population locales, lien.
Acquérir une forme de légitimité politique.
Créations de Harkas dont l’existence sera officialisée en février 1956.
Signifiant « mouvement » en arabe, les harkas sont des unités mobiles réparties sur tout le territoire. Elles sont chargées de participer aux opérations de maintien de l’ordre et constituent le principal appui de l’armée française en Algérie.
Particularité des harkas = ce sont les seules unités supplétives à vocation offensive durant le conflit, c’est-à-dire que ce sont les seules qui participent aux opérations de combat, mais sans autonomie opérationnelle.
Leurs membres sont appelés des Harkis.
Les Harkis sont les supplétifs qui connaîtront le plus de pertes humaines durant le conflit avec plus de 1 800 hommes tués.
Le terme « Harki » s’est, par la suite, généralisé pour désigner l’ensemble des supplétifs ayant combattu aux côtés de la France.
Grande variété de groupes de supplétifs : missions d’appui et de protection.
De 1959 à 1961, l’armée française organise les forces supplétives pour quadriller le territoire et protéger les populations rurales.
Brève typologie :
Moghaznis
Ils sont membres des Sections administratives spécialisées (SAS) : ce sont des structures administratives civiles et militaires créées afin de remédier à la sous-administration de l’Algérie rurale.
Rôle plutôt statique et défensif : protection des SAS et de leur population, maintien de l’ordre.
Ils contribuent également aux missions confiées aux SAS : construire des infrastructures, administrer les villages, soigner la population, et scolariser les enfants.
MAIS, ils pouvaient être appelés à participer à des opérations militaires dans leur secteur.Groupes mobiles de sécurité (GMS), ex Groupes mobiles de police rurale (GMPR)
Ces gardes ruraux ont pour mission d’assurer la surveillance des campagnes et la protection des biens et des personnes.Groupes d’auto-défense (GAD) et Unités territoriales (UT)
Ce sont des bénévoles chargés de protéger les villages et les hameaux d’éventuelles attaques du Front de libération nationale. GAD = la France fournit des armes dans certains villages, mais pas de réelle organisation ni de rangement aux côtés de la France.
En février 1961, on compte 217 000 Algériens rangés aux côtés de l’armée française, dont 65 600 appelés du contingent ; 57 000 Harkis ; 9 100 GMS ; 19 450 Moghaznis et 65 850 gardes d’autodéfense.
III. Les raisons de l’engagement des Harkis dans la guerre d’Algérie
Si certains Harkis s’engagent comme supplétifs par tradition familiale ou attachement à la France, cette attitude est loin d’être systématique. C’est pour cela que l’on ne peut affirmer que tous ont « choisi » de s’engager auprès de l’armée française. L’engagement répond à des logiques familiales, locales ou encore économiques, souvent motivé par la nécessité voire la contrainte.
Beaucoup s’engagent ainsi moins pour la France que contre les violences commises par certains membres du FLN ou de l’ALN.
À la suite de ces violences ou non, certains chefs de villages ou de clans ont poussé à un engagement collectif d’un côté ou de l’autre.
Les raisons économiques ont également pu motiver cet engagement du fait de la solde proposée par l’armée française (d’où principalement des populations rurales pauvres).
Enfin, la conscription a contraint certains à s’engager MAIS nombre important de non-présentation et de désertion [1].
[1] CHAUVIN Stéphanie « Des appelés pas comme les autres ? Les conscrits « français de souche nord-africaine » pendant la guerre d’Algérie », in Raphaëlle Branche, La guerre d’indépendance des Algériens, Perrin, Paris, 2009, p.172-186.
« Entre l’hiver et le printemps 1962, la France (…/…) a tergiversé pour ouvrir ses portes aux Harkis avec un premier "oui" pour une poignée d’entre eux, une dizaine de milliers, puis un refus par peur d’infiltration terroriste d’un bord ou de l’autre, avec interdiction à quiconque de les aider. »

Les accords d’Évian sont signés le 18 mars 1962. Entrant en vigueur dès le lendemain, ils établissent un cessez-le-feu et les règles s’appliquant à celui-ci.
Principe de non-représailles selon lequel :
Extrait du chapitre II | Article 2 |
« Nul ne pourra faire l'objet de mesures de police ou de justice, de sanctions disciplinaires ou d'une discrimination quelconque en raison : | « Les deux parties s'engagent à interdire tout recours aux actes de violence collective et individuelle. |
Des représailles meurtrières, dès le cessez-le-feu et surtout durant l’été puis l’automne 1962, certains anciens supplétifs font l’objet de représailles par les forces indépendantistes et une partie de la population. Le nombre de personnes qui ont été exécutées, torturées ou écrouées demeure indéterminé. Si le rapport à l’ONU du colonel de Saint-Salvy fait état de 150 000 morts, les historiens estiment que plusieurs dizaines de milliers ont été exécutés ou assassinés, sans qu’ils ne puissent, aujourd’hui, apporter une évaluation plus précise et consensuelle.
La démobilisation : décret du 21 mars 1962, il détermine les conditions de démobilisation des seuls Harkis issus des harkas. Plusieurs dispositifs de reconversion professionnelle leur sont proposés, mais un transfert vers la France n’y est pas évoqué et les officiers sont incités à faire pression sur les Harkis pour qu’ils choisissent l’option d’un retour à la vie civile, moyennant une prime de licenciement ou de recasement équivalente à 1,5 mois de solde par année de service.
Le rapatriement tardif pour une poignée d’entre eux : le Premier ministre Michel Debré procède en février 1962 à l’installation d’une commission interministérielle chargée d’étudier les possibilités de rapatriement des Harkis et de leurs familles. Elle conclut à la nécessité du rapatriement des supplétifs et souligne que la France "n’a pas le droit [de les] abandonner" en vertu de la promesse qui leur a été faite au moment de leur engagement.
Les autorités gouvernementales requièrent alors un recensement des supplétifs menacés par le FLN. Le 15 mai 1962, près de 5 000 supplétifs et leurs familles sont dénombrés et bénéficient de ce plan de rapatriement : ils quittent le pays au début du mois de juin 1962.
L’abandon des Harkis
La majorité des Harkis restent en Algérie tandis que d’autres supplétifs qui ne sont pas parvenus à se faire connaître par les autorités administratives embarquent clandestinement pour la France avec ou sans l’aide de leurs officiers.
En juillet 1962, le ministre des Armées Pierre Messmer signale que l’armée française ne dispose plus de moyens pour accueillir les anciens supplétifs dans les camps militaires en Algérie. Ces incertitudes amènent le gouvernement français à interdire fermement les transferts des supplétifs en France et donc à les abandonner, selon les mots du Président de la République le 20 septembre 2021. C’est dans ce contexte que des officiers ou des fonctionnaires, à l’instar du futur général François Meyer, décident de rapatrier des supplétifs, placés sous leur commandement, accompagnés de leur famille.
Ce n’est que le 19 septembre 1962 que le Premier ministre Georges Pompidou ordonna le rapatriement des supplétifs en France.
Il est difficile de déterminer le nombre exact des supplétifs, et des membres de leurs familles, rapatriés en métropole. On estime toutefois que 66 000 d’entre eux sont arrivés entre juin et septembre 1962 (Source : Service central des rapatriés). Au total, il est communément admis qu’entre 80 000 et 90 000 Harkis et leurs familles sont arrivés en métropole entre 1962 et 1967.
V. Des conditions d’accueil et de vie indignes pour les Harkis
L'arrivée massive d’anciens supplétifs sur le territoire à nécessité de les accueillir et de les loger.
Idéal-types et chronologie des principaux lieux d’accueil [2] :
[2] Cette typologie est faite d’idéal-types : les conditions de vie ont pu fortement changer en fonction des sites, notamment concernant les privations de liberté, en particulier concernant les hameaux de forestage.
1. Camps de transit et de reclassement : à partir de juin 1962
L’administration ouvre progressivement, sur le territoire métropolitain, six camps de transit et d’hébergement : camps du Larzac (12), Bias (47), La Rye (86), Rivesaltes (66), Saint-Maurice-L’Ardoise (30), Bourg-Lastic (63).
Anciens camps militaires organisés à la hâte afin d’offrir une solution temporaire face à l’afflux.
Précarité du logement :
Baraquements ou tentes : par exemple, le camp du Larzac, « plateau des mille tentes ».
Conditions sanitaires très difficiles :
Prolifération de nuisibles (rats, poux).
Prolifération de maladies.
Restrictions de liberté : [3] (+ ou – selon les camps)
Barbelés, couvre-feu.
Contrôles entrée et sortie.
L’autorité des chefs de camps.
Rudesse de l’hiver 62-63 :
Difficulté à chauffer des installations provisoires et précaires mal isolées.
Prolifération tuberculose, mortalité infantile (cf. cimetière d’enfants Saint-Maurice-L’Ardoise).
But et difficulté : reclasser = trouver un logement et un emploi (« recasement » selon le vocabulaire de l’époque) car le nombre d’arrivants est supérieur au nombre de sorties [4] d’où des difficultés et une lenteur des reclassements professionnels qui entraînent une pérennisation des structures d’accueil.
[3] À noter qu’à leur arrivée, les restrictions d’entrée et de sortie étaient aussi une demande des Harkis en raison de la continuité de la présence du FLN sur le territoire français.
[4] AN 19920149002 – mars 1963
2. Hameaux de forestage : à partir d’août 1962
Environ 75, dont 35 en région PACA.
Regroupement des familles + nombreuses dans des villages abandonnés ou des régions dépeuplées pour employer les chefs de famille à des travaux forestiers par l'ONF.
But = fournir un logement et un travail tout en vidant les camps.
Isolement géographique :
Priorité donnée à la proximité des chantiers.
Petits villages isolés, souvent dans les montagnes (PACA).
Précarité du logement :
Souvent exigus.
Salle de bain collective dehors, chauffage insuffisant, …
Restrictions de liberté moins prégnantes que dans les camps :
Autoritarisme et arbitraire du chef de camp.
Potentielle mise sous tutelle par la monitrice de promotion sociale.
Solution censée précéder l’intégration à la vie métropolitaine qui se pérennise.
3. Cités d'accueil
CARA de Bias : à partir de janvier 1963 ; Cité d’accueil de Saint-Maurice-L’Ardoise : à partir de juillet 1964.
Deux anciens camps de transit aménagés en cités d’accueil pour les « incasables » [5] = inaptes au travail + revenus insuffisants pour vivre en milieu ouvert (blessures de guerre, infirmités, maladies mentales, âge, femmes seules avec enfants, …).
[5] Selon les termes mêmes de l’administration de l’époque.
- Isolement et entre-soi :
- Manque de transport.
- Scolarisation interne.
- Environnement militaire et carcéral :
- Libres de leurs allées et venues la journée.
- MAIS, visites contrôlées et grillages + gardien.
- Restrictions de libertés et de droits :
- Contrôle et ouverture du courrier.
- Affectation des prestations sociales au financement des dépenses du camp.
- Précarité du logement :
- Surpeuplement.
- Insalubrité.
- Manque d’hygiène :
- Bias : douches payantes, accès 1 fois par semaine ; parasites.
- Aggravation santé mentale :
- Alcoolisme ; maladies psychiatriques ; violences.
Aux conditions de vie difficiles, s’ajoute l’isolement géographique et social :
- Mode d’organisation militaire, voire néocolonial, dans lequel un règlement intérieur impose, dans certains lieux, de lourdes restrictions aux libertés individuelles (couvre-feu, ouverture du courrier, ...) [6]
[6] A noter qu’à leur arrivée, les restrictions d’entrée et de sortie étaient aussi une demande des Harkis en raison de la continuité de la présence du FLN sur le territoire français. Leur continuité au-delà de la persistance de la menace est en revanche plus difficilement justifiable.
L’enfermement et le manque de socialisation des Harkis vivant dans ces structures d’accueil entraînent des difficultés psychologiques, des actes de violences liés au traumatisme de la guerre, au déracinement, à l’alcoolisme et à une ségrégation scolaire des enfants.
Ségrégation scolaire des enfants résidant en structure d’hébergement : instruction précaire au sein des structures renforçant l’isolement, manque de continuité en raison des transferts réguliers d’une structure à une autre.
Ainsi, les enfants de Harkis, ont des parcours personnels souvent marqués par des retards scolaires et professionnels importants : 40 % des enfants de Harkis ne sont pas diplômés et ont quitté le système scolaire avant l’obtention de leur baccalauréat.Racisme ambiant
Conséquence = sentiments d’abandon et d’humiliation, en particulier chez les jeunes, isolés, non-francophones, en quête d’identité, subissant le statu quo malgré les signaux d’alerte aux pouvoirs publics.
1975, révolte des camps de Bias et de Saint-Maurice-L’Ardoise : des enfants de Harkis se révoltent contre leurs conditions de vie et pour la fermeture des camps ; occupation du camp avec pancartes, prise en otage du directeur de Saint-Maurice-L’Ardoise.
⇒ Fermeture des camps (décret publié fin 1975) : cela mène à une prise de conscience des pouvoirs publics de la nécessité de fermer définitivement ces camps, décision officialisée lors du Conseil des ministres du 6 août 1975.
VI. Le processus de reconnaissance et de réparation
Face aux revendications qui se sont poursuivies, les différents gouvernements ont successivement mis en place un certain nombre de dispositifs récapitulés dans le tableau ci-après :
| Mesures | Objet de la mesure | Base textuelle | Forclusion |
|---|---|---|---|
| Mesures de désendettement | Attribution d’aides au désendettement pour les rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (dossiers résiduels) | Loi du 26 décembre 1961, décret du 10 mars 1962 et décret du 4 juin 1999 | Forclose |
| Mesures d’indemnisation | En cas de perte et spoliation définitivement établies des biens (terres, immeubles, …) des rapatriés | Principe d’indemnisation partielle : Art. 4, 3e alinéa de la loi du 26 décembre 1961, décliné par quatre lois successives : 15 juillet 1970, 2 janvier 1978, 6 janvier 1982, 16 juillet 1987 | Forcloses |
| Mesures d’indemnisation | Allocations forfaitaires | Lois des 16 juillet 1987 et 11 juin 1994 | Forcloses, le 31 décembre 1997 |
| Mesures d’indemnisation | Allocation de reconnaissance, tant aux anciens supplétifs qu’à leurs conjoints ou anciens conjoints non remariés | Lois du 30 décembre 1999, du 1er janvier 2003 et du 23 février 2005 | Forcloses, le 20 décembre 2014 |
| Mesures de reconnaissance | Allocation viagère | LFI pour 2016 (Art. 133) et décret du 24 février 2016 | Forclusion partielle au 31 décembre 2016 pour les veuves dont le conjoint est décédé avant le 1er janvier 2016. Recevabilité sous un an pour les autres veuves. |
| Mesures de reconnaissance | Aide spécifique en faveur des conjoints survivants | Loi du 11 juin 1994 (Art. 10) et décret du 29 juillet 1994 |
En vigueur |
| Mesures de reconnaissance | Secours exceptionnels | Instruction conjointe (Min. Intérieur, ONAC, Dél. aux rapatriés) du 8 février 2002 | En vigueur |
| Mesures de reconnaissance | Aide à l’acquisition de la résidence principale | Loi du 11 juin 1994 (Art.7) | Forclose, le 31 décembre 2009 |
| Mesures de reconnaissance | Aide à l’amélioration de l’habitat | Loi du 11 juin 1994 (Art. 8) | Forclose, le 31 décembre 2009 |
| Mesures logement | Secours exceptionnel pour le désendettement immobilier | Loi du 11 juin 1994 (Art. 9) | Forclose, le 31 décembre 2009 |
| Mesures logement | Dispositif de réservation de logement dans le parc locatif privé ou public | Circulaire du 31 mai 1999 | Supprimé en 2001 |
| Mesures logement | Aide au locataire | Circulaire du 31 mai 1999 | Supprimée en 2004 |
| Dispositifs en faveur des enfants d’anciens supplétifs | Allocation pour les orphelins | Loi du 23 février 2005 | Forclose, le 18 mai 2007 |
| Dispositifs en faveur des enfants d’anciens supplétifs | Aides à la formation scolaire et universitaire (versement de bourses complémentaires de celles allouées par l’éducation nationale) | Loi du 11 juin 1994 et du 23 février 2005, décret du 23 mai 2005 | En vigueur |
| Dispositifs en faveur des enfants d’anciens supplétifs | Aides à la formation professionnelle (prise en charge partielle, par l’État, de frais de formations professionnelles et de stages (poids lourds, …) | Loi du 11 juin 1994 et ses décrets d’application, notamment le décret du 17 septembre 2013 | Dispositif annulé par le Conseil d’État |
| Dispositifs en faveur des enfants d’anciens supplétifs | Dispositif des emplois réservés | Loi du 26 mai 2008 | En vigueur |
| Dispositifs en faveur des enfants d’anciens supplétifs | Prise en charge partielle de cotisation retraite | Loi du 22 décembre 2014 (Art. 79) et décret du 29 juin 2015 | En vigueur |
| Dispositifs en faveur des enfants d’anciens supplétifs | Fonds de solidarité | Décret du 28 décembre 2018 | Forclos, le 31 décembre 2022 |
Un tournant : la demande de pardon et la création de la CNIH
20 septembre 2021 : discours d’Emmanuel Macron à l’occasion de la réception à la mémoire des Harkis. il demande pardon aux Harkis, reconnaît les dommages dont ils ont été victimes et admet qu’ils ont été abandonnés par la France et que certains d’entre eux ont été accueillis dans des conditions indignes en métropole à partir de 1962. Il annonce un projet de loi de reconnaissance et de réparation pour les Harkis et leurs familles.
Loi du 23 février 2022 : reconnaissance de la Nation envers les Harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local.
Ce projet de loi porte également la réparation des préjudices subis par les Harkis et leurs familles, du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français.
Création de la CNIH = Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leur famille.
Missions :
Volet reconnaissance : contribuer à la transmission de la mémoire des Harkis et de leurs proches (visites de terrain, recueil des témoignages et des demandes des associations, organisation d’un prix littéraire annuel, …).
Volet réparation : statuer sur les demandes d’indemnisation pour les Harkis et leurs familles ayant séjourné dans une ou plusieurs structures d’accueil listées dans le décret du 18 mars 2022 entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975.
Mission d’expertise historique pour éventuellement renforcer la liste des sites : 45 nouveaux sites ajoutés en 2023. D’autres sites seront proposés après expertise dans le rapport 2023-2025.
La CEDH s’invite dans l’histoire de la réparation due aux Harkis
4 avril 2024 : La CEDH rend sa décision dans l’affaire Tamazount et autres c. France = 5 descendants de Harkis, ayant séjourné au camp de Bias jusqu’en 1975.
Résumé des conclusions :
Non-violation du droit d’accès au tribunal (Art. 6§1) au nom de la doctrine des actes de gouvernement.
Plusieurs violations de la Convention européenne des droits de l’homme :
Droit au respect de la vie privée et de la correspondance (Art.8)
Interdiction des traitements inhumains ou dégradants (Art.8)
Protection de la propriété (protocole n°1)
Spécificité des conditions de vie du camp de Bias insuffisamment prise en compte ð 4 000 euros/année passée au camp de Bias.
La CNIH reconnait les conditions de vie particulièrement indignes des cités d’accueil (en particulier les restrictions des libertés individuelles) et ce, sur une longue durée, contrairement aux camps de transit.
⇒ Proposition de la CNIH d’étendre cette sur-rémunération aux personnes hébergées au camp de Saint-Maurice-L’Ardoise.
VII. Ressources
Rubrique « Les Harkis » du site internet : Les harkis : qui sont-ils ?
Témoignages : rubrique « Centre de ressources / Sources humaines : témoignages » : Découvrir les nombreux témoignages vidéo, oraux et écrits
Rapport d’activité 2022-2023 de la CNIH : Télécharger le "Rapport d'activité 2022-2023 de la CNIH"
Rapport d’activité 2023-2025 de la CNIH (en particulier l’annexe 2 « rapports sur les conditions de vie dans les camps de transit et de reclassement, les cités d’hébergement, et d’accueil et les hameaux de forestage ») – en attente de publication
BRANCHE Raphaëlle (dir.), La guerre d'indépendance des Algériens - 1954-1962, Perrin, Paris, 2009, 356 p.
CNIH : commission de réparation à titre principal et complémentaire
Ce 17 avril 2025, la Commission nationale indépendante Harkis a statué, en commission restreinte de réparation, sur les…
17 avril 2025

Bilan cumulatif des réparations à titre principal du 1er juin 2022 au 17 avril 2025
La Commission nationale indépendante Harkis (CNIH) présente les données chiffrées des bilans cumulatifs des réparations…
18 avril 2025

CNIH : Bilans cumulatifs des réparations de janvier à avril 2025
La présidente de la Commission Harkis dresse, ci-dessous, les bilans des réparations principales et complémentaires validées…
18 avril 2025