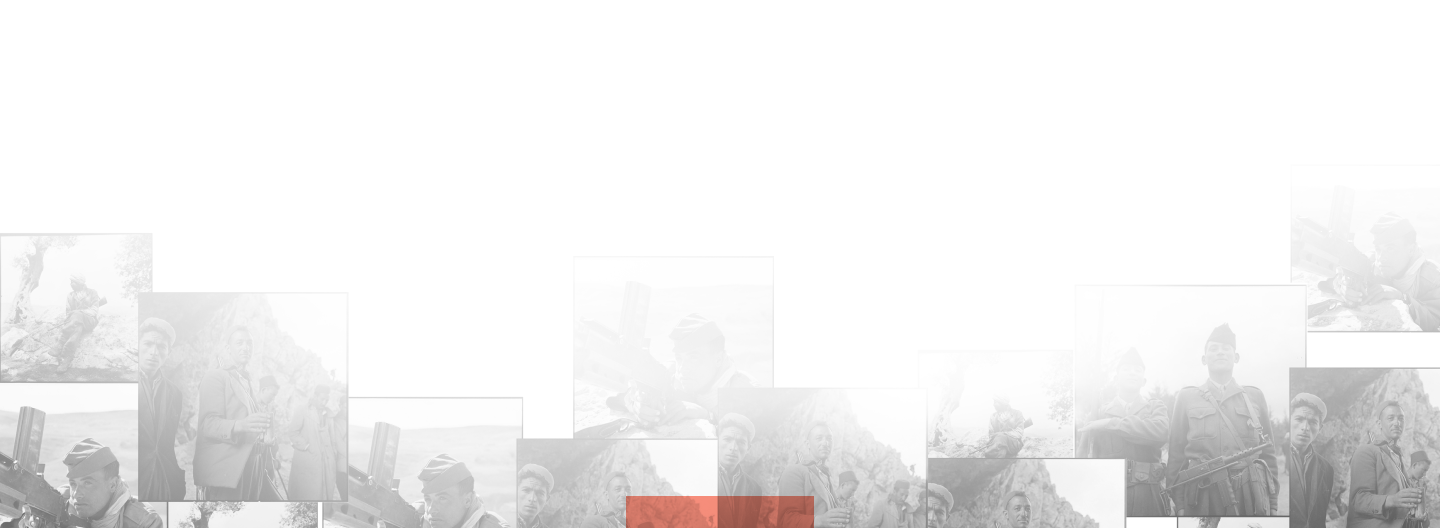Entretien avec l’auteur, Michel Messahel
| Quelle a été la genèse de votre volonté de raconter l’histoire de votre famille, et à travers elle, de témoigner pour la mémoire des Harkis ? | |
J’ai grandi à Lussac, une commune de Gironde, au contact des gens du terroir. Dès trois ans, je suis allé à l’école publique. La vie rurale était mon quotidien. J’entendais le son de la cloche de l’église. J’observais les traditions locales : les vendanges, la fenaison, la soupe du jimboura qu’on offre dans mon village après avoir tué un cochon. Si ce mode de vie m’a imprégné de la culture rurale française, je voyais bien que mes parents avaient une origine différente. J’ai alors cherché à savoir d’où je venais. Mes parents étant discrets et pudiques, ils ne me parlaient pas de leur passé. Vers treize ans, j’ai commencé à questionner mon père, même s’il n’était pas disposé à me répondre. Il m’a fallu user de beaucoup de délicatesse afin de ne pas réveiller chez lui des souvenirs trop douloureux. C’est aussi en observant et en écoutant simplement mes parents que j’ai recueilli des informations car quelquefois, ils parlaient entre eux de l’Algérie devant mes frères, mes sœurs et moi-même. Parfois, des personnes qui rendaient visite à ma famille ou que je connais à Lussac, des anciens combattants, des collègues de mon père, des élus municipaux, me rappelaient qu’il avait servi l’armée française. Pour commencer à comprendre l’histoire de mes parents, je suis donc parti de ce lien avec l’armée française, puis j’ai étendu mes recherches à l’Algérie française. À l’histoire personnelle, s’est ajoutée, en arrière-plan, celle d’une guerre tragique, la guerre d’indépendance et le sort terrible des Harkis. Or, je trouvais peu de documentation relative à leur vie quotidienne, avant, pendant et après la guerre. En outre, la plupart des Harkis étaient analphabètes et les témoins directs disparaissaient. Il y avait donc urgence. J’ai débuté l’écriture du livre sans trop savoir où elle m’emporterait. Le texte partait dans tous les sens. Et puis, à un moment, tout s’est mis en ordre et un fil conducteur s’est imposé. Au départ, ce récit devait rester confidentiel, mais l’intérêt qu’ont manifesté les premiers lecteurs de ce texte m’a amené à poursuivre ma recherche et à la rendre publique. | |
| Vous affirmez dans votre livre : “Il n’existe pas une seule histoire de Harkis, mais tellement !” Comment s’entremêlent pour vous la mémoire individuelle et la mémoire collective ? Quel est l’intérêt de la micro histoire ? | |
Lors de mon enquête, j’ai découvert que l’engagement de mon père a tenu à peu de choses malgré son amour véritable pour la France. Au départ, il ne souhaitait pas prendre parti, n’ayant rien à reprocher au colon qui l’employait. Mais la terreur imposée par le FLN aux gens du peuple comme lui, pour qu’ils choisissent le camp de l’indépendance, l’a poussé à s’engager pour la France. Chaque être humain a une trajectoire qui lui est propre, car elle est liée à sa famille, à ses proches, à ses rencontres, à ses déplacements, à ses expériences vécues, etc. Et les Harkis n’y échappent pas. C’est en enquêtant au plus proche de la vie des gens que la grande Histoire se comprend dans toute sa densité. Cela permet aussi de faire tomber les clichés et de mieux comprendre les événements. | |
| Comment votre famille a-t-elle reçu l’annonce de votre volonté de raconter leur histoire ? | |
À partir de 2007, je n’arrêtais pas de poser des questions à mes parents sur leur vie en Algérie et je notais leurs réponses. « Mais que fais-tu ? » me demande un jour l’un de mes frères. « J’écris l’histoire de la famille. » Mon père s’est alors inquiété : « Fais attention à ce que tu dis et à ce que tu écris » m’a-t-il prévenu. Le souvenir de cette mise en garde m’a accompagné tout le long de la rédaction du livre, et encore aujourd’hui quand je suis invité à prendre la parole. Elle m’a incité à mesurer mes jugements et mes analyses. Ma mère me laissait faire et m’encourageait en me prononçant de temps en temps : « Bonne chance ». Mes frères et sœurs ne comprenaient pas trop ma démarche. Ils se disaient : « Mais qu’est-ce qu’il lui prend ? ». Eux étaient préoccupés par leur vie quotidienne. Moi, j’étais surtout animé par le devoir de mémoire. Aujourd’hui, ils pensent que mon travail peut servir à faire tomber certains préjugés et à éviter des amalgames. Car des gens en France confondent les Harkis et les immigrés qui ne sont pas venus en métropole pour les mêmes raisons. | |
| Vous en êtes aujourd’hui à la troisième édition de votre livre, dont vous avez commencé le travail d’écriture en 2007. Vous attendiez-vous à ce que ce travail soit si long ? Pourquoi avez-vous ressenti le besoin d’ajouter de nouveaux témoignages à votre récit ? | |
Je ne m’attendais pas du tout à autant d’années d’écriture. Quatorze ans ont été nécessaires entre le début de la première édition et la publication de la troisième. Cela s’explique par le fait que le récit s’appuie principalement sur des témoignages oraux. Il a fallu en recueillir suffisamment et voir la cohérence entre toutes ces sources. J’ai écrit la première édition avec des témoignages de ma famille et de mon entourage. Mais en participant à des salons du livre et à des dédicaces, j’ai rencontré de nombreuses personnes que je ne connaissais pas. Je les ai écoutées, beaucoup d’entre elles avaient besoin de parler de la guerre d’Algérie. Il s’agissait de pieds noirs, d’anciens militaires, de fonctionnaires français qui avaient travaillé en Algérie, d’enfants d’anciens appelés du contingent. Tous ces gens se sont confiés à moi. J’ai entendu des choses très intéressantes qui avaient toute leur place dans mon livre pour l’étoffer et l’affiner. | |
| Votre livre met énormément l’accent sur le rôle de l’humanisme et de la solidarité à petite échelle dans l’intégration de votre famille. Comment percevez-vous l’action individuelle et locale comparée à l’action étatique concernant les Harkis ? | |
Je crois que l’intégration de ma famille est due en grande partie à tous les gens que mes parents ont croisés sur leur chemin, qui les ont aidés d’une façon ou d’une autre. Bien sûr, mes parents avaient la volonté de s’en sortir et d’aller vers l’autre, et de saisir les mains tendues. C’était une personne qui aidait à rédiger une lettre dans le camp militaire de l’Ardoise (Gard), un voisin qui gardait un des enfants de la famille, un maire qui embauche mon père malgré des réticences de certains de ses conseillers, une voisine métropolitaine qui invite ma mère à un goûter. L’État n’est pas resté inerte mais les actions qu’il engageait envers les Harkis pour améliorer leur vie quotidienne manquaient terriblement de publicité, si bien que ces-derniers, dont beaucoup, comme on l’a vu, étaient analphabètes, n’étaient pas informés. Et les rares fois où ils l’étaient, constituer un dossier avec toutes les pièces justificatives demandées relevait de l’exploit. Là où l’État a été déficient, c’est d’avoir tant tardé à parler officiellement de l’histoire des Harkis. Il a fallu attendre 2001 pour qu’un civil, le président Jacques Chirac, institue une journée d’hommage à ces hommes et leurs familles. | |
| Dans une interview donnée au journal Sud Ouest, vous parlez d’un “devoir de mémoire” en évoquant l’illettrisme de nombreux Harkis, pour lesquels l’oralité est centrale dans la transmission de la mémoire. Quels autres aspects ont régi votre sentiment de “devoir” ? N’est-il pas également important de conserver cette culture de l’oralité ? | |
J’ai souhaité qu’on garde non seulement des témoignages sur ce qu’ont vécu les Harkis, mais aussi que les générations suivantes, à commencer par la mienne puissent vivre plus épanouies, dans toute leur dimension citoyenne et personnelle grâce à une réelle connaissance de l’histoire de leur famille, qui va au-delà des idées reçues. Comment fait-on pour conserver cette culture de l’oralité ? Et peut-on la conserver ? Elle est liée à un style de vie particulier à un moment donné de l’Histoire. La garder dans un contexte différent est difficile. Elle exige des qualités particulières qui se développent à partir d’un manque, celui de la maîtrise de l’écrit, comme le sens aigu de l’observation. | |
| Vous mentionnez à de nombreuses reprises votre attachement pour la France et les valeurs républicaines et regrettez un discours parfois manichéen concernant la guerre d’Algérie et le sort des Harkis. Comment maintenir selon vous une vérité historique nuancée sans nier la souffrance de l’ensemble des Harkis et de leurs familles ? Quelles limites alors de la micro-histoire ? | |
Je l’ai dit plus haut, j’ai rencontré de nombreuses personnes lors de salons du livre et de colloques. J’ai constaté que l’Algérie française demeure un sujet brûlant. Beaucoup de mes interlocuteurs qui ont vécu cette période étaient à vif. Pas les Harkis eux-mêmes, dont la plupart étaient réfugiés dans le mutisme, mais leurs enfants, des pieds noirs, des militaires, aussi bien de carrière qu’appelés. J’ai entendu : « On nous a abandonnés », « On nous a foutus dehors », « Je ne veux pas en parler, car c’est un mauvais souvenir ». Ceux qui s’exprimaient, pour certains traumatisés, donnaient leur version des faits. Je les écoutais attentivement. J’essayais d’apporter des nuances, de montrer par exemple que les raisons de l’engagement des Harkis variaient d’un homme à l’autre, mais quand je voulais leur expliquer combien les causes et l’enchaînement des faits étaient multiples, c’était quasiment impossible. Eux avaient raison, les autres avaient tort. J’ai été surpris de voir que des personnes issues de la deuxième génération, même nées en France, toutes communautés confondues, avaient la même vision de l’Histoire que leurs parents. Il est si difficile de se déprendre de l’héritage familial ! Pour ce qui me concerne, je dois dire que l’écriture du livre a changé mon point de vue. Je me suis rendu compte de la complexité de cette page de l’Histoire. Ce fut un long cheminement. Et c’est là peut-être que se trouvent les limites de la micro-histoire : la difficulté de prendre de la hauteur pour écrire un récit commun qu’on pourra transmettre via l’école de la République. | |